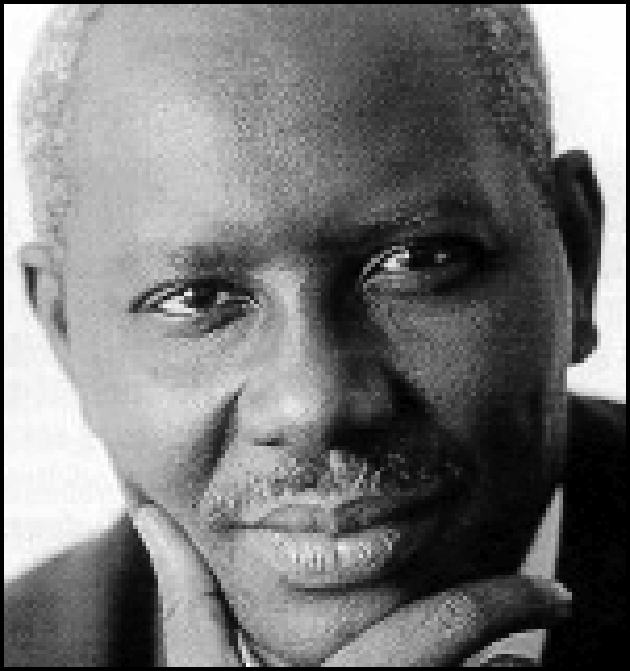Alessandro Corio : M. Diop, en lisant votre roman Murambi. Le livre des ossements, j’ai été littéralement choqué. J’ai arrêté plusieurs fois la lecture parce que presque chaque page produisait en moi un conflit énorme ; j’avais la certitude que ce que vous racontiez c’était l’horrible et indicible vérité et que vous aviez trouvé la façon la meilleure pour vaincre la résistance des mots. Au même temps, mon esprit et ma rationalité se refusaient d’accepter que tout ça ait été possible et je continuais à me demander » mais comment, pourquoi tout ça s’est passé dans les rues, dans les églises, sous les yeux de tout le monde … » ; quelqu’un a parlé d’un génocide de la proximité et, en effet, si on compare les événements du Rwanda à l’holocauste de juifs … là c’était dans de camps, la population ne connaissait pas les particuliers, c’était au milieu d’une guerre … mais au Rwanda, tout le monde a tourné son regard, c’était les voisins qui tuaient, même les pères ou les fils … Alors je vois la nécessité et le devoir d’un long processus de connaissance et de mémoire pour arriver à comprendre ce qui nous échappe. Je crois que le génocide du Rwanda n’est pas seulement l’affaire du Rwanda et même pas de l’Afrique, mais du monde entier, de l’humanité, de chacun de nous … Je voulais vous demander, avant de parler plus strictement de littérature, quel à été votre parcours personnel, même intime si vous voulez, vers la connaissance et la compréhension de ce qui s’est passé au Rwanda …
Boubacar Boris Diop : Vous savez, aujourd’hui quand vous parlez avec les personnes qui ont été victimes du génocide, les rescapés, qui racontent leur histoire, la question qu’ils posent le plus souvent eux-mêmes c’est : » pourquoi ? » … ils ne peuvent pas expliquer ce qui est arrivé. Ils ont l’impression que c’était une espèce de fatalité qui leur serait tombée dessus. Et là je me souviens d’avoir rencontré une jeune femme qui s’appelle Marina et qui est la démonstration même du fait que c’était un génocide de proximité. Une jeune femme de 26 ans, son père avait essayé de la tuer … heureusement ça ne s’est pas passé … et elle raconte son histoire ; pendant qu’elle parlait elle riait … elle riait et elle pleurait au même temps. Alors, c’est vraiment une situation tout à fait exceptionnelle … et ce n’est pas facile de répondre à cette question. Maintenant, comment moi j’ai été amené à approcher le génocide du Rwanda, ce que vous appelez mon parcours personnel ; et bien, il y a juste que lors que l’événement ait eu lieu en 1994 … très franchement … je ne me suis rendu compte de rien ! C’est pourquoi je ne critique pas les européens en disant » oui, ils sont indifférents ! « . Moi, africain, j’ai pensé que le Rwanda c’était comme le Libéria, à cette époque la Sierra Leone, l’Algérie … les gens s’entretuent, et voilà puis on regarde son match de football et après on dira » ils sont tellement malheureux « , mais bon, voilà c’est comme ça vraiment ma première réaction. Je n’ai rien compris ! Et la cause du fait que je n’ai rien compris c’est qu’à la fin du génocide j’étais en train d’écrire un roman, un roman intitulé Le Cavalier et son ombre. Et dans ce roman je parle du Rwanda, mais j’en parle exactement comme un ignorant ; c’est à dire que je ne sais pas ce qui s’est passé, je sais que ce n’était pas bien de tuer les gens … je me dis … et puis, je suis presque content de moi, j’ai versé ma petite larme, j’ai fait mon devoir … et bien, la vie continue ! Et puis maintenant, j’ai eu l’occasion d’y aller, en 1998, donc quatre ans après le génocide dans des circonstances un peu longs à expliquer, on ne peut pas s’arrêter là dessus, mais en 1998, on me propose, avec d’autres auteurs africains, d’aller au Rwanda, parce que c’était très important et on n’avait rien compris. Je dois avouer que, en tant que journaliste, j’étais très d’accord pour y aller, mais, en tant qu’écrivain, peut-être que j’étais un peu réticent, parce que je me disais » oh, bon, les rwandais ils se sont entretués, les Hutus et les Tutsis, qu’est-ce que moi je vais faire là-bas ? … laissons les morts enterrer les morts … comment on dit dans l’Évangile « . Et puis, malgré tout, j’y vais, j’y vais et j’ai eu la chance d’approcher … je suis venu avec des préjugés, mais je les ai laissés de côté, j’ai mis tout ça entre parenthèses, j’ai commencé à regarder, j’ai commencé à écouter, j’ai commencé à lire, là-bas même, j’ai commencé vraiment à me remettre en question et, au bout de très peu de temps, je me suis rendu compte d’une première chose. C’est que, vraiment, dans le monde moderne, dans le monde des télécommunications, des technologies et tout, il y a une chose très bizarre, c’est qu’on peut tuer 10000 personnes par jour, pendant trois mois en direct à la télévision, tout le monde en parle, mais personne n’en est frappé ! C’est presque magique, c’est vraiment bizarre, on ne peut même pas dire qu’on n’en parle pas, parce que du Rwanda on a beaucoup parlé, on a parlé tout le temps ; mais à l’arrivée tu vas là-bas et tu te rends compte que, au fond, la principale qualité de la presse internationale ce n’est pas de mentir en cachant les faits, c’est de mentir en bombardant les gens de faits ! Et si on bombarde les gens de faits, comme d’ailleurs on brouille les cerveaux des ordinateurs … quand vous les brouillez vous mettez des millions des messages et, à un moment donné, l’ordinateur ne comprend rien. Au fond, par rapport au génocide c’était comme ça, et là petit à petit moi je commence à comprendre. D’abord je mesure l’énormité de la catastrophe, je mesure son caractère unique même dans les crises africaines … le Rwanda ça n’a rien à voir avec tout le reste ! Je comprends mieux les mécanismes politiques et culturels qui ont été à l’œuvre dans ce travail de … dans cette solution finale, ce travail de destruction, et puis surtout, le génocide ce n’est plus simplement des chiffres, des idées, mais je parle avec des victimes, je vois leur visage et ça revient des souffrances authentiques. Évidemment, moi, je me suis remis en question et je me dis : » Écoute, Boris, tu es journaliste, tu sors des philosophies, tu es écrivain, si toi tu n’as rien compris, comment l’africain moyen peut comprendre ? Et là, évidemment, j’ai eu honte de moi, je me suis dit qu’au fond, dans les écoles, on n’apprend rien ! On n’apprend même pas à regarder la réalité ! Je répète que ce qui est frappant avec le génocide du Rwanda c’est que tout est là, sous les yeux, mais personne ne voix rien ! Oui, tout est là …
Gabriella Ghermandi : Sì, ma nessuno ha risposto alla domanda: « Perché? » … nobody gave answer to a question : » Why ? « . And then, also because we had a lot of messages, but these messages were just economical messages, because the information is an economical source! And so we can receive strong images, we can watch the eyes of the people on TV, but we don’t say anything ’cause we can’t understand anything …it’s an empty communication.
B.B.Diop : Yes, I agree, I completely agree with this, it’s true!
A.C. : Oui, c’est plat, totalement plat et si vous le demandez à un italien, je crois que le 90-95% des italiens ils ne savent pas où se trouve le Rwanda et je crois que c’est au moins le 99% qui ne connaissent pas ce qui s’est passé au Rwanda! Peut être l’association Rwanda-génocide, mais pas plus que ça est passé à travers les médias !
B.B.Diop : Malgré tout ça, aujourd’hui moi je suis encore optimiste, parce que moi je dis toujours que la mémoire d’un génocide c’est une mémoire paradoxale et plus le temps passe moins on oublie ! C’est ça. Si on prend l’exemple de la Shoà … (telefonata di Pap Khouma) … On parlait de l’optimisme. Si par exemple vous prenez l’exemple de Primo Levi quand il publie ses livres à la sortie des camps, personne ne veut le publier, tous les éditeurs lui disent » non « , mais, petit à petit même pour la Shoà ça a mis du temps à s’imposer et je pense que, pour le Rwanda aussi, on sent le même phénomène, parce que dans le génocide, deux où trois ans après, personne n’en a parlé, mais, à partir du dixième anniversaire, on sent vraiment que les gens ont compris quelque chose de vraiment important … justement moi j’étais aux Etats-Unis au mois d’octobre, et puis, à la télévision, on interroge Bill Clinton, et on lui demande qu’est-ce qu’il regrette le plus de quand il était à la présidence et il a dit : » Je regrette de n’avoir pu rien faire pour le Rwanda ! » ; ça veut dire que … avant, s’il l’avait dit, j’aurais dit : » c’est quelqu’un qui cherche à plaire « , mais aujourd’hui il n’est plus le président, il a terminé sa carrière politique et le Rwanda n’est qu’un petit pays sans importance. Et alors, pourquoi Bill Clinton a dit ça ? Et puis en ce moment il y a beaucoup de films qui passent etc. Alors je pense que, malgré tout, dans la conscience humaine il y a l’idée de ce qui c’est passé au Rwanda et du pourquoi. Et c’est pour ça que je dis que je suis optimiste. On en parle de plus en plus !
A.C. : On peut aussi dire que la mémoire est une construction, donc elle peut aussi s’accroître plutôt que s’affaiblir …
B.B.Diop : C’est ça qui met en colère, le fait que la mémoire soit une construction, c’est à dire qu’on ne peut parler du génocide que sur la durée ; c’est à dire qu’au moment où le génocide a eu lieu, en général personne n’a voulu rien savoir ! Et d’ailleurs le fait que ce soit une construction sur la durée c’est que, si on le regarde bien, le crime du génocide, comme dans le cas de la Shoà, a été commis par le parents, mais ce sont les enfants qui portent le poids du crime. C’est eux qui, aujourd’hui, vont s’interroger sur le crime commis par leur parents. Alors, il faut du temps pour qu’on commence à rompre le silence et l’indifférence.
A.C. : C’est comme ça que, dans votre roman, c’est le fils qui découvre que le père à été l’un des organisateurs du génocide à l’école de Murambi ; il se croyait innocent, mais il est rattrapé par le crime du père.
G.G. : I would like to ask you a question. I’am half italian; my mother she’s from Eritrea and I grew up in Etiopia. You know that, between Etiopia and Eritrea, it has been a long war and somethig is still going on. I have some idea of why, but nobody really knows the real motivations of this conflict. Is it the same for you in Rwanda? You can immagine why this happends but you can not really find the answer?
B.B.Diop: But you say that you know why this happened between Eritrea and Etiopia …
G.G. : Yes, I think that, according to me, this is the consequence of colonialism. When Menelik, the emperor of Etiopia, sold a piece of Eritrea to a naval company … ha venduto un pezzo di Eritrea ad una compagnia navale per poter acquistare le armi con cui poi ha vinto la guerra di Adua. Ha venduto l’unica cosa che era vendibile agli stranieri, la baia di Aksa che era un porto importante e con i soldi che lui a preso …
B.B.Diop : Now I understand!
G.G. : And with this money he bought the arms with which he won the battle of Adua; after this company gave this piece of land to the king of Italy. Then, from these facts began the colonisation. So, people from Eritrea felt they had been sold by the king and they felt themselves like slaves. This happened at the end of nineteen century. This hate is yet never ended.
B.B.Diop: At the same time, the same story happened in Rwanda; I mean that, also in Rwanda, colonialism was the main cause. C’est à dire qu’il y a une comparaison à faire entre le Rwanda d’une part et l’Ethiopie et l’Eritrée d’autre part. Il y a une guerre en Ethiopie qui continue jusqu’à présent, mais personne ne connaît les raisons. Vous venez d’expliquer les raisons, qui sont liées à la colonisation. Moi je pense que aussi dans le cas du Rwanda c’est toujours à la fin du XIXème siècle qu’on retrouve les racines de ce qui se passe au présent ; c’est la même base : il s’agit de la colonisation ! Moi, je travaille beaucoup sur ça. Et aujourd’hui quand vous le dites, quand vous dites que c’est la colonisation qui a transformé le Rwanda et qui a fait qu’en 1994 il y a eu un million de morts, les européens ils ne veulent pas l’entendre ça ! Ils ne veulent pas.
A.C. : Les européens ils pensent que la colonisation est terminée en 1945, même avant, est cela n’est pas vrai, parce que si les Hutus tuent les Tutsi c’est parce que le discours et la pratique du pouvoir colonial a établi la différence ethnique entre Hutus et Tutsis. Ils ne savent même pas qui est Hutu et qui est Tutsi s’ils ne regardent pas sur leur pièce d’identité. Il n’y a pas d’autre façon, parce que c’est la même langue, la même culture, le même dieu …
G.G. : Its the same thing that happened between Eritrea and Etiopia, the two regions who hate each other for the consequence of colonialism. The old people of my country tells that God said that if they don’t stop hating each other he would make their land just as dust where only the mouses will play …
B.B.Diop : I can tell a lot of stories which are evidents of that … par exemple … je peux raconter beaucoup de petites histoires qui exposent cela, mais ce qui est important de savoir c’est que, avant la colonisation, le Rwanda n’était pas une société juste et équilibrée, pas du tout ! C’était une société dans laquelle la minorité, les Tutsis, dominait la majorité, les Hutus. Ca c’est clair : domination politique. Les Hutus sont les gens qui travaillent la terre, les paysans, les Tutsi sont les éleveurs. Mais, malgré cette domination, pour plusieurs siècles il n’y a jamais eu de massacres, il n’y a jamais eu de tueries. Il y avais un équilibre dans la société. Et, vous savez, à un moment donné dans le roman il y a une jeune femme, qui s’appelle Jessica, qui dit ça : supposons que dans le passé les Tutsis étaient très cruels et très criminels contre les Hutus ; ce n’est pas vrai, mais on le suppose. Est-ce que ça donne aujourd’hui aux descendants de dire qu’on va tuer tous les Tutsis. Et elle ajoute : c’est comme si on disait, après l’Apartheid : » Les nègres ils ont souffert pendant trois siècles ! Maintenant on va tuer tous les Blancs ! » Personne ne l’accepterait. Nobody would accept that. Il y a quelque chose de assez injuste dans tout ça.
A.C. : Dans le film » Hôtel Rwanda « , qui vient de sortir dans les salles, il y a un personnage, Romeo Dallaire, qui est le chef des la mission de casques bleus. À un certain moment il dit : » Tout ça va se passer parce que vous, vous êtes des africains, des nègres. Ca c’est la vérité que vous devez accepter. Tout les Blancs sont en train de s’enfuire, et vous allez rester seuls, parce que vous êtes des nègres ! « . Même si ça c’est un tabou du langage politique, c’est la vérité.
B.B.Diop : Vous savez, Dallaire il dit aussi une autre chose, qui n’est pas rapportée dans le film. Il dit que pendant ce période il a parlé avec un officiel américain qui lui a dit : » Nous, les américains, n’intervenons qu’à partir d’une condition : la vie d’un soldat américain, pour l’opinion publique, vaut la vie de 89.000 citoyens rwandais ! » Il a dit ça. Et aujourd’hui au Rwanda il y a une nouvelle définition du négationnisme. Lorsqu’on considère le négationnisme dans le cas de la Shoà, les négationnistes disent que les camps de la mort n’ont jamais existé et qu’il n’y a jamais eu de chambres à gaz. Ce n’est pas vrai. Mais, lorsque les gens veulent nier le génocide du Rwanda ils ne disent pas que ce n’est pas vrai. Ils disent que c’est vrai, que tout ça a eu lieu, mais que ça n’est pas tellement important. C’est ça le problème. Donc, le négationnisme concernant le Rwanda se pose comme une affirmation. Les négationnistes ne nient pas. Ils disent que c’est vrai, mais ils ajoutent que en Afrique les personnes s’ils ne meurent pas dans un génocide … Oui, c’est la fameuse phrase de François Mittérand. En 1994 ses conseillers lui ont dit : » Monsieur le président, ce qui se passe au Rwanda dépasse les limites et c’est dangereux pour la France d’être aussi engagée du côté des tueurs ! « . François Mittérand a répondu : » Dans ce pays là, un génocide n’est pas un problème du tout ! « . C’est ça qu’il a dit.
A.C. : Au milieu de votre roman, quand Cornelius découvre que son père a été l’un des responsables du génocide de Murambi, il ne pleure pas. Il commence a rire. Tout ça c’est tellement paradoxale et inconcevable que l’unique réaction c’est un éclat de rire, qui est encore plus tragique que le désespoir total. Je n’arrivais pas à comprendre, mais maintenant je comprend. Ca c’est l’abîme le plus noir. Ca dépasse la raison.
B.B.Diop : J’ai vu plusieurs fois des gens au Rwanda qui racontaient ce qui leurs était arrivé pendant le génocide, et ils riaient, parce que c’était l’unique façon de tolérer cet absurde. Par exemple, j’ai lu dans le livre d’un rescapé qui s’appelle Yolande Mukagasena il y a une personne qui lui dit : » J’ai tué trois-cent personnes, mais je ne me souviens que du premier ! « . Et à un moment donné on disait que dans les prisons du Rwanda on libérait, parce qu’il y avait plus de cent-mille prisonniers, on était obligé de libérer des gens, alors on a décidé qu’on aller libérer les gens qui avaient tué moins de cinq personnes. C’est l’horrible vérité. Moi, dans le roman, il y a des choses que je n’ai pas voulu mettre, parce que c’était trop horrible. Par exemple, j’ai rencontré cette femme, qui dans le roman s’appelle Rosa Karemera, elle nous a parlé d’un épisode horrible. Son fils était prêtre, elle était là et les miliciens ont demandé au prêtre de coucher avec sa propre mère, devant tout le monde, en public. Ca, j’ai pas pu le raconter dans le roman ! Ensuite, ils ont tué la mère. Et, en racontant l’histoire, elle a ajouté : » heureusement ils ont tué lui aussi ! « . La question que chacun se pose, et doit se poser aujourd’hui, c’est : » Qu’est-ce que j’étais en train de faire quand tout ça avait lieu ? « . À mon avis, les africains sont très mal placés par rapport au génocide : ils se sont montrés indifférents ! Nous, les africains, nous avons étés les premiers à être indifférents ! Il y a eu une seule exception : Nelson Mandela. Il a été le seul à crier : » Attention à ce qui est en train de se passer au Rwanda ! « . On dit que l’Afrique c’est le continent de la haine de l’autre, mais ça n’est pas vrai. On dirait plutôt que l’Afrique est le continent de la haine du même, et les racines de cette haine sont liés à l’aliénation coloniale ! Il n’y a jamais eu des problèmes avec les européens ou les américains, voire les ex-colonisateurs. C’est ça qui fait que le continent africain est tellement paradoxal ! C’est un continent qui est très accueillant pour les gens qui viennent de l’extérieur, mais celui qui est à côté, celui on le hait ! Et pour moi ça c’est la haine du même. C’est ça le fond du problème, ça veut dire qu’on a honte de soi ! Je hais l’autre, pas parce qu’il est différent de moi, mais parce qu’il me ressemble ! Et c’est moi même que je hais à travers lui. Il faut qu’on règle d’abord ce problème.
A.C. : Oui, je crois que cela est la structure même de l’aliénation coloniale en Afrique ; il y a beaucoup de différences, mais ceci est le commun dénominateur. La colonisation africaine n’a pas eu besoin de beaucoup d’hommes ni d’armes, parce qu’elle a utilisé les différences, la haine et la volonté de pouvoir des hommes africains les uns sur les autres pour les dominer ; et le Rwanda c’est seulement l’une des conséquences les plus visibles. Pensons aussi au Libéria, à la Sierra Leone, à l’Eritrée ou à la Somalie ! Quand le pouvoir colonial c’est déplacé à l’extérieur (il n’est d’ailleurs pas disparu du tout) avec la décolonisation, toutes les tensions accumulées à l’intérieur par des siècles de pouvoir de l’homme blanc se sont déchaînées.
B.B.Diop : On ne peut pas les distinguer … avant, peut être, on pouvait, mais maintenant il y a tellement de mariages entre eux que cette distinction ne compte pas : vous parlez avec quelqu’un, vous comprenez qu’il est Tutsi, mais, si vous regardez les livres d’histoire, normalement il est Hutu. Et pourtant les gens se sont tués pour ça !
A.C. : Primo Levi avait dit, après le génocide, qu’il avait découvert son identité juif seulement avec le génocide. Il savait bien sur d’être juif, mais avant il se sentait italien. Et ça c’est paradoxal et au même temps révèle très bien à quel point l’identité ethnique est une construction culturelle. La construction de l’identité juive est historiquement plus forte. Tu est juif si tu est fils de mère juive. Pour les Hutus et les Tutsi c’est même pas ça ! C’est une construction au cent pour cent.
B.B.Diop : Oui, c’est une chose totalement inventée. Mais, puisqu’on parle de Primo Levi, il y a un passage chez lui, je crois qu’il se trouve dans Naufragés et rescapés ( » I sommersi e i salvati « ) où, à un moment donné il parle des nazis dans le camp et il les insulte ; pour les insulter il utilise un mot très bizarre : » Pygmées « . Moi, je l’ai remarqué parce que je suis africain. C’est pour dire à quelle point, dans la conscience humaine, dans chacun de nous, il y a un angle mort de telle sorte. Là, en parlant de la Shoà, de tout ce qu’il a souffert, du respect qu’on doit à l’être humain, il le dit avec une telle sincérité et puis » hop « , il y a un mot qui sort. C’est terrible ça !
A.C. : Moi aussi j’ai remarqué chez Primo Levi quelque chose d’inexplicable de la nature humaine. Il nous décrit comme, pendant les procès aux nazis et aux SS qui ont suivi le génocide, plusieurs entre eux avait complètement oublié tout ce qui s’était passé, tout ce qu’ils avaient fait ! C’est paradoxale, et il ne mentait pas consciemment, parce que leur inconscient avait effacé tout ça de leur mémoire !
B.B.Diop : C’est comme celui qui dit : » J’ai tué trois-cent personnes, mais je me souviens seulement du premier ! « .
A.C. : Et ça c’est incroyable, parce que si quelqu’un dit des mensonges, on peut les reconnaître ou, quand même, il y aura un sentiment de culpabilité qui reste caché quelque part. Mais là le pouvoir du refoulement était tellement fort, qu’ils ne mentaient pas quand ils disaient que tout ça n’avait existé, parce que cela avait été effacé des leurs esprits !
G.G. : I would like to make you some questions, but before I have to explain you something. I’m just leaving for Eritrea, for my mother’s house in a short time. My mother is a victim of the italian colonisation and for this it’s fifty-five years that she doesn’t visit her village. Now she’s seventy-six years old and she has prayed me to bring her home, and now I have to organize that. I grew up in Etiopia but I have not a very good feeling with Eritrea, but this is because of the colonisation. My mother grew up with the idea that she wanted to be white and she didn’t want to be eritrean cause she had suffered very much. This is a consequence of the apartheid and the deculturation produced by the italian colonialism! Also after the war, a lot of years after the end of colonisation a lot of black peoples wanted to become white. So my mother moved to Ethiopia because in Ethiopia there was no racism. And for this I’ve never had a good feeling with Eritrea, cause she didn’t pass me this feeling. Eritrea remains something very distant from me. I feel half italian and half etiopian, but Eritrea is something very far from me. Now, I would like to make you some questions. I know that you wrote a book in wolof. Also Pap told me: « Please, say to Boubacar that I have his book in my house, but I cannot read it very much because his wolof is very hard for me. My wolof is a wolof of the streets ». I suppose that your decision to stop writing in french and to start writing in wolof comes from your experience in Rwanda. But Pap sayed to me that, according with him, this is not a book for wolof peoples, but it’s something for you. It’s like a step in your personal evolution as writer. I would like to understand better the motivations of your choice of this language and if in the future you are going on writing in wolof.
B.B.Diop : D’abord, je pense que je vais quand même continuer à écrire en français, même si, maintenant, je n’ai pas très envie. Donc, je n’ai pas dit » Ah, maintenant j’arrête d’écrire en français ! « . Je vais continuer peut-être, parce que une langue, même quand elle a été imposée, c’est bien, elle peut nous permettre de parler etc., mais je pense quand même que le plus important pour moi je vais l’écrire dans ma langue maternelle qui est le wolof. J’ai toujours pensé que c’est bien d’écrire dans sa langue maternelle, mais j’ai également toujours pensé que moi je ne serais pas capable. Un peu comme Pap Khouma maintenant. Mais, quand j’étais au Rwanda j’ai vu vraiment à quel point la question culturelle était importante. J’ai vu que le fait que nous ne sommes pas encore indépendants de la France est extrêmement dangereux et que la véritable indépendance c’est l’indépendance culturelle. Et moi je dis toujours que sans la langue, l’identité tourne à vide ! L’identité sans langue c’est une identité creuse et vide. J’ai commencé à écrire dans ma langue maternelle qui est le wolof. Au début c’était très difficile, mais j’ai insisté, j’ai forcé et je suis heureux d’avoir écrit ce livre en wolof. J’ai écrit plusieurs romans en français et ce roman en wolof ; maintenant je travaille sur une pièce de théâtre, mais pour moi, mon meilleur livre est ce livre en wolof ! Et je suis sûr que si Pap Khouma s’arrête et il décide d’écrire en wolof, il se rendra compte que ce n’est pas pareille. Maintenant il dit que mon wolof est trop élevé ; non, pourtant non, pas du tout. Moi aussi, mon wolof c’est le wolof de la ville, c’est très simple, mais la structure du roman est extrêmement complexe. Et peut être qu’il vit depuis longtemps dans un autre environnement linguistique, c’est ça son vrai problème. Il est dans un environnement linguistique italien. Moi, je vis au Sénégal dans un environnement linguistique où on parle ma langue maternelle. La grande différence que j’ai vu, après avoir écrit ces romans en français et ce roman en wolof, je me suis rendu compte d’une chose. Lorsque j’écris en français, j’écris avec des mots, mais quand j’écris en wolof, j’écris avec des sonorités ! C’est pas pareille.
G.G. : I’m both italian and amaric, but when I think in italian is something mental and rational, when I think in amari it’s emotional and sensual.
B.B.Diop : I use to be alone, I like to be alone … et quand je reste seul pendant quelques jours je commence à parler tout seul et je parle toujours dans ma langue maternelle! Parce que ça vient de très loin. Je pense qu’il ne faut pas non plus croire que revenir à sa propre langue maternelle ça résolve tous les problèmes ! Il y a beaucoup de difficultés et peut-être qu’on doit en parler.
A.C. : Pourquoi vous avez dit que vous ne voulez pas que votre dernier roman soit traduit en français ni en d’autres langues ?
B.B.Diop : Non, c’est juste en français. Parce que le Sénégal est un pays francophone. Si vous proposez dans les librairies les livre en français et en wolof, le plus simple pour les gens c’est de lire le livre en français et comme ça le livre en wolof va mourir petit à petit. Voilà, c’est ça. Mais ici en Italie, où en Allemagne les sénégalais ne lisent pas en allemand ou en italien, donc ce n’est pas un problème. Mais si au Sénégal tous les gens lisent en français et on leur donne le livre en français c’est fini, parce que pour eux c’est plus simple. En effet en ce moment le livre est en train d’être traduit en français, il y a deux personnes qui le traduisent en français, mais je leur ai dit que quand ils auront terminé de le traduire on le gardera. On le publiera, mais plus tard, dans cinq-six ans. Il faut d’abord que le livre s’impose dans la langue en laquelle a été conçu. Parce que c’est aussi un combat politique ! Parce que c’est comme si les gens me disaient » Ah, c’est très bien que tu écris en wolof, ça veut dire que tu as une culture dans ta langue maternelle etc. Bravo ! Mais, maintenant, donne-nous le livre dans une vraie langue ! « . Voilà.
G.G. : Dunque, se ho ben compreso, è un modo per te di fare un passo indietro rispetto alla colonizzazione e all’alienazione culturale che passa anche attraverso la lingua e di restare in Africa, di scrivere per l’Africa in un modo impegnato. E’ una pratica di decolonizzazione.
B.B.Diop : Tout à fait, oui, je suis entièrement d’accord, c’est un choix politique. Et maintenant tous le crimes du continent africain je les lis à travers la colonisation.
A.C . : Ce retour à l’Afrique, ça veut dire pour vous le retour à une Afrique d’avant la colonisation, où ça n’est pas possible et il s’agit de reconstruire une nouvelle Afrique en se séparant du pouvoir politique et économique, mais aussi culturel de l’Occident ?
B.B.Diop : Je viens d’écrire un article sur la Côte d’Ivoire sur Le Monde Diplomatique du mois de mars, et là j’explique la crise de la Côte d’Ivoire en mettant en avant le rôle de la France. Pour moi c’est un combat politique, c’est à dire que je pense que c’est surtout un combat de libération. Mais, comme l’a bien montré Amilcar Cabral, un combat de libération politique n’est pas possible sans un combat de libération culturelle. Les deux vont ensemble. Et aujourd’hui il ne s’agit pas du tout de dire » Oui, on retourne à l’Afrique d’avant la colonisation « . Non, il faut être dans le monde moderne, mais en apportant sa propre force, en croyant en soi, et puis en sachant que au fond, les problèmes qui se posent chez nous trouvent des solutions chez nous. Mais le grand problème en Afrique aujourd’hui c’est que si d’un côté on critique la colonisation avec la main gauche, au même temps on utilise la main droite pour demander. Mais si vous critiquez, mais vous n’avez pas de dignité et de fierté on dira : » Oui, il critique, mais au même temps il prend ce qu’on lui donne ! « . Mais je suis optimiste et parfois je pense qu’en Afrique, depuis ces trois dernières années, surtout dans le monde anglophone la situation s’améliore petit à petit. Il y a encore beaucoup de corruption, beaucoup de pauvreté, d’injustice, mais quand on compare à il y a dix ans, quinze ans, on a l’impression, avec des pays comme le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Uganda, on a l’impression qu’ils s’améliorent un petit peu, très lentement. Mais ce n’est pas la même chose pour les pays francophones !
G.G.: Sono rimasta molto sconvolta da una cosa. La Francia è, insieme alla Germania, l’unico paese europeo ad essersi opposto alla guerra globale di Bush, dimostrando un sincero attaccamento agli ideali democratici europei. Questo però stride fortemente con le orribili implicazioni di questa nazione (post)coloniale in quello che è accaduto in Rwanda e che sta accadendo oggi in Congo. Mi rendo conto che queste differenti scelte geopolitiche non sono altro che strategie che nascono da interessi di tipo politico-economico, e non da sinceri ideali democratici.
B.B.Diop : Oui, je suis d’accord. À propos des implications de l’état français dans le génocide du Rwanda, je vous conseille de lire un texte étonnant, intitulé L’horreur qui nous prend au visage : l’état français et le génocide au Rwanda, éditions Karthala, Paris. Je vous conseille vraiment de lire ça. C’est écrit par des français, pas par des africains. C’est un procès et tous les témoignages sont dedans. Il s’agit de témoignages prises au Rwanda et en France sur le rôle de la France dans le génocide rwandais. C’est un livre de six-cent pages, extrêmement important.
A.C. : On ne connaît pas beaucoup à propos des implications du pouvoir dans le génocide ; on a parlé du rôle du fils du président Mittérand et d’autres hommes puissants du gouvernement français. Je voudrais parcourir maintenant ce thème des responsabilités extérieures du génocide. J’ai identifié au moins cinq sujets qui ont participé directement ou même passivement au génocide : la France, l’ONU, la Belgique, les Etats-Unis, la communauté internationale, l’église … À un certain moment, le personnage du Docteur Joseph Karekezi affirme : » Ce qui est arrivé au Rwanda est, que cela vous plaise ou non, un moment de l’histoire de France au vingtième siècle « . Quel a été le rôle de ces acteurs politiques ? On est encore aujourd’hui, d’après vous, en plein colonialisme ?
B.B.Diop : Oui, tout d’abord, à mon avis, il faut éviter les positions caricaturales comme : » Oui, les rwandais ils n’ont rien fait, il vivaient tranquillement et puis les gens sont venus, ils leur ont donné des armes et ils se sont entretués « . C’est trop facile de dire ça. Je crois que les rwandais ils doivent accepter, je l’ai dit d’ailleurs dans le roman, la responsabilité de leur propre histoire. Ils doivent accepter ça. Mais il y a aussi des gens qui ont une autre position caricaturale. Ils disent : » Ah non, pas ça. Laissez les occidentaux tranquilles. Là, les africains ils s’entretuent et puis ils disent que c’est nous ! « . Ca aussi c’est la caricature. Je crois que le monde est gouverné par des forces terribles et la meilleure façon de contraster ces forces c’est vraiment de réfléchir très lentement avec objectivité et sérénité. Si l’on plonge d’un côté ou de l’autre, c’est la même chose, ce sont deux opposés qui se touchent. Il faut voir quels sont les mécanismes et pour moi il faut chercher quels sont les faits dans l’histoire ; ne pas juger les gens parce que, s’ils sont français, on dira » Oui, les colonisateurs belges … » etc. ; c’est trop philosophique ! C’est un processus très long, qu’il faut poursuivre avec de très petits pas. Le processus historique qui a amené au génocide de 1994 a commencé, d’après ce que j’ai lu dans les livres, en 1959 avec l’accession du Rwanda à l’indépendance dans certaines conditions. Il y a eu des dates importantes, mais une de dates les plus importantes c’est le 5 juillet 1973, où il y a un coup d’état. Habyarimana il prend le pouvoir. Mais, à partir du moment où Habyarimana prend le pouvoir, les belges ils se retirent un peu et les français deviennent les maîtres du Rwanda. C’est le gouvernement français qui a soutenu le coup d’état. L’avion dans lequel Habyarimana est mort était un avion militaire du président Mittérand. C’est encore une énigme historique, mais peut-être qu’on découvrira les responsables : on accuse les FPR, on accuse le Hutu Power, on accuse la France. Ce sont les trois suspectés. Cette question est abordée dans le livre, mais j’ai refusé de donner un réponse définitive. Il faut chercher, mais ça c’est très difficile. Quand même, après 1973 c’est la France qui forme l’armée rwandaise, qui entraîne les miliciens, les militaires, qui achète les armes, qui soutient le pays à l’ONU, elle fait vraiment tout. Et quand il est apparu que les protégés de la France allaient perdre le pouvoir en 1994, ils ont monté l’Opération Turquoise, qui a permis d’amener au pouvoir le FPR. C’est donc le gouvernement qui a organisé le génocide ; c’est des françaises qui le disent dans le livre dont j’ai parlé, pas moi. C’est l’ambassade de Matignon( ?) qui a organisé tout ça. Et comment est-ce qu’on peut appeler ça ? Maintenant, après avoir énuméré les responsabilités, on peut chercher les raisons.
A.C. : Donc, le président et le premier ministre français ils connaissaient tout ce qui était en train de se passer ?
B.B.Diop : Tout … tout … tout. Une seule fois ils sont intervenus. L’Hôtel Milles Collines, dont on parle dans le film, appartient à la Belgique, à la Sabena. Il y avaient beaucoup de Rwandais qui étaient réfugiés là-bas.
A.C. : Oui, on le dit dans le film ; c’est le chef de la Sabena qui appelle le gouvernement français et parle avec le bureau du premier ministre et le premier ministre, à travers une chaîne de commandements, au dernier moment il fait rentrer les militaires.
B.B.Diop : Cela montre très bien le pouvoir de la France ; ça c’est passé seulement parce que l’hôtel était un hôtel de la Belgique. Mais je crois que le gouvernement français n’a pas dit » Bon, il y a un génocide, on le soutient « . Non. Au Rwanda c’est en ’59 qu’on a commencé à tuer. Et c’est des massacres ! Parfois on tue 5000 personnes, parfois 30000, dans les années ’70 on a tué 200000 personnes, mais bon, il s’est toujours passé inaperçu. Tout ça c’est une tragédie de la décolonisation, une tragédie post-coloniale. Mais toutes les décolonisations ne conduisent pas à un génocide. Il n’y a pas eu de bonnes décolonisations, mais ici la question est s’il y a eu des génocides ou pas, soit quelles sont les conséquences de la décolonisation. Je veux aussi vous signaler une chose. Le premier occidental à avoir parlé du génocide au Rwanda, et on ne l’avait pas écouté, c’était le philosophe Bertrand Russel. Celui qui avait fait les tribunaux sur la guerre du Vietnam. Et il avait dit ça sur la Radio du Vatican. C’était en 1961.
A.C. : Quant à l’expression » génocide « , je sais que, en 1994, elle n’a pas été utilisée jusqu’au mois de juin, et ils utilisaient seulement l’expression » actes de génocide « , parce que le pouvoir américain avait ordonné de ne pas utiliser ce mot, parce que, au moment où ils auraient utilisé cette expression, selon la convention de Genève, l’ONU aurait été obligé d’intervenir.
B.B.Diop : Oui, c’était à la moitié de Juin et les massacres sont terminés le 14 juillet, donc il restait trois semaines de massacres ; c’était presque fini. En effet les américains ne voulaient pas qu’on prononçait le mot » génocide « . Ils voyaient tout à travers leurs satellites, il y a beaucoup de films effectués par les satellites américains. Mais le problème des américains c’était que, si l’on utilisait le mot génocide, ils devaient intervenir. En Somalie, dix-huit soldats avaient été tués et traînés dans les rues de Mogadiscio. Ca avait traumatisé l’opinion publique américaine. Et ils ont dit : » Nous on ne veut pas entrer dans cette histoire-là ! » L’opinion publique est trop importante, et c’est ça qui les a empêchés d’intervenir ! Tous les historiens sont d’accord sur ça, y compris les historiens américains. On sait bien, même si l’on regard ce qui se passe en Irak aujourd’hui, que un mort américain vaut comme dix-mille mort irakiens !
A.C. : Est-ce que vous pouvez nous expliquer l’occasion qui a conduit au projet » Écrire par devoir de mémoire « , qui est-ce qu’a participé au voyage au Rwanda et qu’est que vous avez fait là, comment est-ce que vous avez recueilli les donnés et les témoignages etc. ? Est-ce que vous êtes retourné au Rwanda après ? Comment est-ce que le publique rwandais a réagi à votre roman ?
B.B.Diop : L’idée est partie en 1995, à Lille, dans le nord de la France, où chaque année se déroule une manifestation littéraire qui s’appelle » Fest’Africa » ; on était là quand, au Nigeria, ils avaient tué l’écrivain Ken Saro-Wiwa. On l’a appris à Lille et tout le monde est resté très choqué, parce que certains connaissaient bien Ken Saro-Wiwa et puis on s’est dit, mais vraiment l’implication des écrivains africains dans les problèmes du continent, ça ne suffit pas, parce que on écrit des livres, on les écrit dans des langues étrangères, il y a très peu de gens qui les lisent et ça a vraiment très peu d’efficacité ! Qu’est-ce qu’on peut faire pour arrêter la main des dictateurs ? Et là on n’a pas trouvé des réponses, mais on a continué à réfléchir et dans la réflexion, après avoir quitté Lille, on s’est rendu compte que, quand même, la chose la plus grave qui s’était déroulé en Afrique c’était le Rwanda. Et aucun de nous n’avait écrit vraiment sur ça. Moi, j’avais écrit, mais j’étais passé à côté, je n’avais pas compris ! Alors, on a dit que ce qu’on devrait faire quand même, c’est essayer d’aller au Rwanda et, une fois qu’on est là-bas, qu’on essaye de témoigner, d’écrire etc. D’ailleurs, au départ, on avait dit : » Ceux qui ont envie d’écrire, ils écrivent ; ceux qui n’ont pas envie d’écrire, ils n’écrivent pas « . Il y avait un auteur du Kenya, un auteur du Sénégal, deux auteurs du Rwanda même, dont l’une vivait ici à Rome, Jean-Marie Vianney Rurangwa et puis un auteur de Djibouti, un auteur de la Côte d’Ivoire, un auteur du Burkina Faso, deux auteurs du Tchad ; je vous conseille surtout de lire le livre de Koulsy Lamko, qui s’intitule La phalène des collines et pour moi c’est un très bon livre !
A.C . : Vous avez changé complètement votre façon d’écrire en passant de Le Cavalier et son ombre à Murambi ; j’aimerais vous laisser un peu parcourir votre chemin littéraire pour comprendre qu’est-ce que ça a changé avec l’expérience du Rwanda dans votre façon d’écrire, par exemple dans la complexité des personnages, dans la langue, dans la structure du récit etc.
B.B.Diop : Vous savez, quand on était au Rwanda et quand on a dit au gens qu’on était des écrivains et on était venus pour savoir un peu ce qui s’était passé et pour témoigner, ils on dit : » D’accord, mais il ne faut pas que vous écriviez des romans ! « , parce que pour eux, ce qui était important c’était vraiment de faire comprendre et là c’était pas possible d’écrire Murambi comme j’avais écrit Le Cavalier et son ombre. Là, j’étais dans le jeu littéraire, j’avais à faire à des personnages. Avec Murambi j’avais à faire à des personnes ! Ce n’est pas pareille. Et des personnes avec lesquelles j’avais parlé. J’ai parlé avec des gens, et je savais que ces personnes allaient être dans mon livre. Donc, il me fallait respecter leur souffrance, il me fallait vraiment trouver les mots les plus simples. C’était aussi une écriture d’urgence, et ça explique pourquoi le livre a une structure si simple : il fallait surtout faire comprendre ! Et j’ai aussi écrit ce livre en pensant aux personnes plus jeunes que moi ! Pour moi c’était très important et c’est pour ça que le texte est non seulement très simple, mais aussi très rythmé. Il n’y a pas de phrases trop longues, des choses trop compliquées. C’est très simple. Je voulais que les jeunes de dix-huit ans, de vingt ans etc. le lisent et que ça ne les ennuie pas ; que même si après avoir lu le livre ils n’ont pas compris le Rwanda, qu’il leur donne envie de comprendre ! Je me rappelle que quand j’ai terminé d’écrire le roman, j’ai envoyé une mail à un ami, en lui disant : » Je viens de terminer Murambi ; c’est un livre que j’ai écrit avec beaucoup de cynisme ! « . Et je lui ai explique qu’est-ce que ça voulait dire. Pour moi le cynisme ça voulait dire que j’avait écrit Murambi avec beaucoup de mépris pour la critique littéraire et pour la littérature ! Voyez, dans Le Cavalier et son ombre il y a une sorte de labyrinthe littéraire, c’est un conte obscur mais délicieux parce qu’on va jouer à cache-cache des histoires, on va se perdre dans le jeu narratif etc., c’était pour le plaisir du texte …
A.C. : Moi aussi, dans Murambi, j’ai aperçu l’effort d’arriver à une écriture presque » nettoyée « , avec des phrases très brèves qui disent tout ce qu’il faut dire, sans ne laisser rien d’ambigu, sans rien cacher ; on perçoit vraiment l’effort de passer au-delà du mur des mots. Vous dîtes, à un certain point : » Tout cela est absolument incroyable. Même les mots n’en peuvent plus. Même les mots ne savent plus quoi dire « .
B.B.Diop : Oui, et s’il s’agissait de musique, on pourrait dire que j’écrivais » un ton au dessous « . Aussi, vous savez, le lecteur habituel a envie de croire que les choses qu’on lit sont imaginaires ! Comme ça il peut dormir tranquille. Si j’avais dit certaines choses, le lecteur aurait dit : » Ah, mais il a beaucoup d’imagination ! Mais tout ça n’est pas vrai, heureusement « . L’être humain a envie de croire que le monde marche bien. Les gens veulent regarder les matchs de football, il veulent rester avec leur famille etc. Nous avons la tendance à fuir la réalité. Et si vous êtes là, et si vous racontez toutes ces choses absolument horribles, les gens vont se dire » Ce n’est pas possible ! » ; et moi je voulais vraiment, avec des faits très simples, donner l’impression que tout cela est vrai ! Il était important que à aucun moment le lecteur ne dise : » Il est en train d’exagérer « . Et c’est pourquoi c’est si simple.
A.C. : En lisant le livre, je me suis arrêté beaucoup de fois. J’étais contraint à fermer le livre et à réfléchir pour arriver à comprendre et à accepter que tout ça c’était vrai ! Ce n’était pas question de méfiance, c’était vraiment un travaille intérieur qui a accompagné la lecture.
B.B.Diop : Moi-même j’ai souffert en écrivant, c’est facile à comprendre. Je suis tombé malade deux fois et j’ai du arrêter deux fois d’écrire.
A.C. : En revenant sur la question de la langue : d’après vous en quelle façon est-elle liée à la question de l’identité culturelle, à l’aliénation coloniale, à la question du public? Qu’est-ce que vous pensez des écrivains qui utilisent la langue française en la déstructurant et en la réinventant, comme par exemple Ahmadou Kourouma, dans son dernier roman Allah n’est pas obligé ? Cela n’est plus du français, c’est un français d’Afrique, une sorte de créole, même si là il s’agit plus d’une ré-invention, d’une création littéraire. Vous croyez que ça peut être efficace où c’est au contraire une limite ?
B.B.Diop : Je déteste ça, vraiment. Pour moi Kourouma est un grand auteur ; il a vraiment réussi, mais je déteste ce concept, parce que ça repose sur des idées qui sont extrêmement dangereuses ; ça veut dire que le destin des langues africaines est de mourir lentement à l’intérieur de la langue française. Lorsque vous faites un travaille comme celui de Kourouma, après le malinké occupe une parte très insignifiante, il reste comme vidé ! Je ne me sens pas du tout d’accord. C’est un processus de créolisation. La deuxième chose c’est qu’il s’agit, pour Kourouma, de révolutionner la langue française. Je pense que il appartient aux écrivains français de révolutionner leur propre langue ! Pourquoi un écrivain africain devrait-il révolutionner la langue française ? C’est un peu bizarre ça. Non seulement on nous colonise, mais au même temps on doit apporter un souffle nouveau à la langue du colonisateur, en laissant mourir la nôtre ! En réalité je crois que derrière tout ça il y a une intention politique ; je pense que, parmi les peuples colonisateurs, les français sont les plus attachés à leur langue, et ils on compris très bien la dimension politique de la langue. Ils s’efforcent de tout faire pour garder les africains à l’intérieur de la langue française. C’est l’unique façon pour la France de rester un pays qui compte dans le cadre de l’impérialisme de la mondialisation. C’est une démarche politique et au même temps une forme de néo-colonialisme culturel ! Et je vous fais remarquer une chose : depuis qu’il y a des africains qui écrivent en langue française, jamais aucun d’eux n’a été jugé digne de recevoir le prix Goncourt. Le seul noir qui a gagné le prix Goncourt en 1921, je crois, c’est le martiniquais René Maran. Presque un siècle d’écriture des africains dans la langue française. Les français sont bizarres ; ils disent : » Oui, venez dans notre langue. Parlez même à votre façon là, comme Kourouma, on ne comprend pas très bien, mais restez à votre place ! « . Dans l’esprit des français il y a une grande différence entre être un écrivain français et être un écrivain francophone ! Ce n’est pas pareil. L’écrivain francophone il est toujours une marche dessous. C’est assez paradoxal, donc je suis absolument opposé au projet Kourouma, parce que c’est un procès de créolisation de la langue française que, de toute façon, retarde le développement des langues africaines !
A.C. : Je suppose que vous n’êtes pas du tout d’accord avec les écrivains martiniquais de la créolité comme Patrick Chamoiseau ou même Édouard Glissant.
B.B.Diop : Oui, mais il y a une différence, parce que le créole est une langue qui existe, mais la langue de Kourouma n’existe pas dans la réalité ; personne ne parle comme dans les livres de Kourouma. Je ne suis pas contre l’utilisation du créole, parce que je ne connais pas cette langue ni son histoire, mais je me méfie du mouvement de la créolité. Je suis en train d’écrire un texte intitulé : De la créolité, ou comment tuer l’ancêtre Bambara. C’est-à-dire que pour moi le mouvement de la créolité est une façon, pour les antillais, des reprocher à Césaire d’avoir fait croire que les Antilles étaient africaines. Il y a quelque chose de vrai en ça, parce que le mouvement de la créolité dit : » Nous ne sommes pas seulement d’origine africaine, nous sommes d’origine asiatique, nous sommes d’origine européenne, nous sommes un mélange « . Ca c’est vrai, mais ce qui m’intéresse c’est pourquoi ils le disent maintenant ? Je pense que les Martiniquais, qui se veulent français, leur problème c’est qu’on les considère comme des africains. Pour moi le mouvement de la créolité c’est un peu dans ce sens là qu’il fonctionne et c’est la raison pour laquelle je m’en méfie beaucoup. Je peux vous donner un exemple : dans les années ’30, je crois, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, c’est-à-dire l’antillais et l’africain noir, se sont rencontrés sur les bords de la Seine et pendant toute leur vie ils ont parlé, ils ont eu des choses à se dire. À un moment donné, quand on faisait une anthologie de littérature négro-africaine on avait dedans Roumain, Césaire, Senghor, Birago Diop, Mongo Beti, on avait tous dedans ! Mais aujourd’hui quand je rencontre des écrivains des Antilles, je n’ai absolument rien à dire ! On peut se saluer, prendre un café, et puis … basta ! C’est ça. Et quand les auteurs africains organisent des choses sur la littérature et tout ça, ils ne participent pas. Pour moi, le mouvement de la créolité dépasse leur intention de s’affirmer créoles ; indirectement, ils s’affirment français ! Dans le Cahier du retour au pays natal, Césaire parle de son ancêtre Bambara et je pense que la créolité ça consiste à tuer l’ancêtre Bambara de Césaire ! Donc, je pense que l’aspect littéraire et linguistique est très différent de l’aspect idéologique de ces mouvements. Kourouma, il écrivait dans une langue que personne ne parle, alors que le créole est une langue.
A.C. : Moi, j’ai toujours pensé à la langue, ou plutôt au langage de Kourouma comme une tentative, un effort de décoloniser la langue française, de fracturer son unité et sa pureté qui correspond à son universalisme. D’habitude le puristes de la langue française défendent la langue classique des contaminations, lesquelles par contre représentent toujours un facteur décolonisant et d’innovation de la langue.
B.B.Diop : Mais je crois qu’il faut se demander pourquoi les français aiment tant Kourouma ; il faut se poser la question. D’après moi c’est parce qu’ils ont compris que s’ils veulent enfermer les auteurs africains dans les cadres de la langue française classique c’est de les laisser écrire en un français impur, comme la langue de Kourouma.
A.C. : Donc c’est mieux d’accepter des variétés de français » pas pur « , plutôt que de tout perdre, n’est-ce pas ? Moi, j’ai écrit une thèse sur Édouard Glissant, en étudiant aussi ses théories sur la » créolisation » et sur la » Relation » ; il a pris les distances du mouvement de la créolité en affirmant qu’ils couraient le risque d’une nouvelle fixation identitaire, en oubliant que chaque identité ce n’est qu’un processus qui ne s’arrête pas ; en se voulant créoles ils couraient le risque d’oublier aussi l’importance des racines africaines, de ce qu’il appelle, dans son langage poétique, » le Grand Pays au delà des Eaux « . Moi aussi je pense que la contamination identitaire, si elle n’est pas appauvrissement ou déculturation, peut devenir une grande richesse pour le monde entier. Ca ne veux pas dire une perte de racines, mais c’est quelque chose de nouveau qui s’ajoute aux racines ; il ne faut pas rejeter, il faut dialoguer.
B.B.Diop : Oui, il faut assumer son propre côté africain ; il ne faut pas se réveiller chaque matin en se disant : » Je suis africain « , mais moi, ce que je leur reproche c’est même pas de se vouloir français, c’est de se vouloir parisiens ! C’est terrible, quoi. C’est un peu tragique. C’est pour ça qu’on n’a rien à se dire, et ça c’est tragique. Leurs Afrique c’est l’Afrique de la télévision, mais un écrivain doit aller au delà de ça. Si on va casser ce lien profond, on ne peut pas communiquer. Ils sont si loin de Fanon ! Il était martiniquais, mais il va presque mourir pour la révolution algérienne. Il faut renouer le dialogue, mais dans la vérité, ça veut dire même dans la douleur ; sinon on continue à s’ignorer !
A.C. : Si je pense à la condition culturelle des DOM, que Glissant décrivait déjà dans Le Discours antillais, c’est effrayante ! Elles sont tout à fait des colonies complètement dépendantes de la France et pas plus qu’un marché.
B.B.Diop : J’ai parlé avec un auteur guadeloupéen, Ernest Pépin et j’ai lui dit que j’aurais compris le mouvement de la créolité s’ils se présentaient comme un mouvement de libération nationale, parce que vous êtes quand même des colonies françaises. Les auteurs de la créolité, à ma connaissance, ne parlent jamais de ça. Il m’a répondu : » Nous ne sommes pas une colonie. Nous sommes une colonie de vacances ! « .
A.C. : Pendant les années ’70 c’était différent ; il y avait un mouvement politique pour l’indépendance dont Glissant faisait partie. La génération suivante a abandonné ce combat et a accepté sa propre condition vide d’identité politique et culturelle, en se transformant en marché pour les voitures et en village de vacances pour les riches de l’hexagone !
Je voudrais vous poser une dernière question à propos du rôle de l’oralité dans l’écriture africaine et dans vos romans, et aussi quel est le rôle de la littérature, d’après vous, en Afrique et dans le monde entier, aussi à travers les littératures de la migration.
B.B.Diop : Bon, c’est-à-dire que, pour ce qui est de l’oralité, je vous fais remarquer que c’est très difficile de trouver un auteur africain, même qui prétend d’écrire en manière très classique, chez lequel il n’y a pas de traces d’oralité. Même inconsciemment, je pense que chez nous l’oralité c’est quelque chose de très fort et je me suis rendu compte, en écrivant mon dernier roman en wolof, Doomi Golo, qu’il a une très forte charge orale. Je crois que l’oralité c’est un peu l’avenir, non pas le passé, de la littérature africaine, et c’est pourquoi, au lieu de publier la traduction de mon roman en français, on est plutôt en train de faire une version audio du roman, de graver un CD. Au fond notre chance c’est qu’il y a, dans le monde entier, un retour à l’oralité : versions orales de livres, lectures à la radio, à la télévision et je crois que ça c’est un peu la chance, aujourd’hui, de la littérature africaine, même si nous ne la saisissons pas ! Aujourd’hui il y a deux littératures africaines : les littératures africaines écrites en anglais, en français et en portugais, sont des littératures de transition. Pour moi, la question de la langue maternelle ne se pose pas ; autrement dit, ce qui est important pour la littérature c’est la langue de la vie : quelle est la langue qu’on parle autour des textes ? Si j’étais en Italie depuis vingt ans et tout le monde autour de moi parle en italien, ça serait normal que j’écrive en italien ! La langue de la littérature c’est un écho du monde réel, on écrit avec ces échos-là! C’est pour ça que je pense que les livres des auteurs africains écrits dans des langues européennes font partie d’une littérature de transition qui est appelée à disparaître. Prenez l’exemple de Ngugi Wa Thiong’o : il écrivait en anglais et maintenant il écrit en kikuyu. Ce qui est étonnant est qu’en Afrique, contrairement à ce qu’on croit, il y a plus de livres écrits dans les langues nationales que de livres écrits dans les langues européennes, mais le problème c’est qu’on n’en parle jamais ! En 2003 en Zimbawe on a publié cinquante romans en anglais et un millier de romans dans les langues parlées en ce pays. Mais le problème c’est qu’on n’en parle pas dans les journaux, à la radio etc. Si je prend l’exemple du Sénégal, il y a beaucoup de gens qui croient que je suis l’un de premiers à avoir écrit en wolof : c’est une question soi politique que culturelle, parce que, dans les pays francophones, c’est clair que la France regarde de mauvais œil le développement des langues africaines.
A.C. : J’aimerais vous raconter un petit anecdote : quand j’ai commencé à lire les littératures africaines et, en général, les littératures post-coloniales, quand je parlais de mon travail, tout le monde me regardait presque étonné en disant : » C’est vrai ? Il y a des africains qui écrivent des romans ? « . Ici, on connaît seulement la littérature européenne et américaine. Notre ignorance est incroyable !
www.el-ghibli.provincia.bologna.it/index.php?id=2&issue=02_09&sezione=3&testo=1
Posté par rwandaises.com