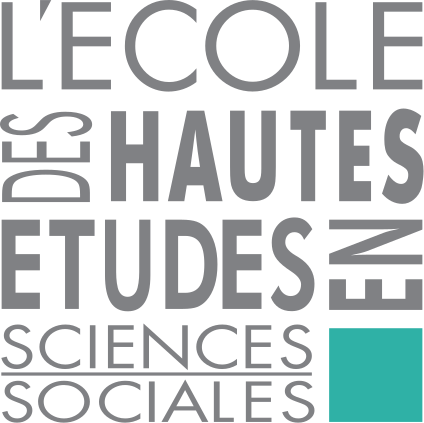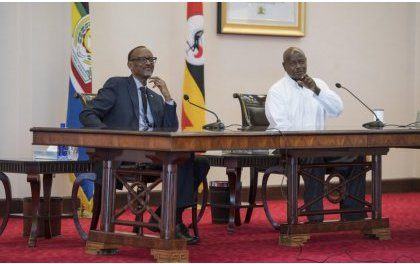Des étudiants dénoncent la participation d’Hubert Védrine, secrétaire général de l’Elysée pendant le génocide de 1994, à un séminaire « semi-confidentiel » de l’EHESS.
Un militaire français près du camp de réfugiés de Kivumu, au Rwanda, le 12 juillet 1994

Un militaire français près du camp de réfugiés de Kivumu, au Rwanda, le 12 juillet 1994. PASCAL GUYOT / AFP
Tribune. « Tout le passé pèse sur le présent », disait l’historien Fernand Braudel, créateur de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et ancien président de la VIe section de l’Ecole pratique des hautes études (EPHE), devenue l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Au cours du printemps 1994, entre 800 000 et 1,2 million de personnes, des [Ba]Tutsi dans leur immense majorité, sont massacrées au Rwanda sous les yeux de la communauté internationale. Une « neutralité coupable », d’après les mots de Claudine Vidal, sociologue spécialiste du Rwanda, qui pèse encore aujourd’hui telle une ombre sur la possible implication de puissances étrangères, dont la France.
Version officielle
Des documents désormais déclassifiés des archives de la présidence de la République française témoignent du fait que, dès 1990, des fonctionnaires français sur place avertissent régulièrement des risques de massacre de grande ampleur et des intentions génocidaires d’une partie de l’état-major rwandais. On peut citer le général Jean Varret, ancien chef de la mission militaire de coopération d’octobre 1990 à avril 1993, qui a déclaré lors de son audition devant la mission d’information parlementaire française que « lors de [son] arrivée au Rwanda, le colonel Rwagafilita [lui] avait expliqué la question des Batutsi : “Ils sont très peu nombreux, nous allons les liquider.” » Le soutien fourni au gouvernement rwandais par l’Etat français jusqu’aux accords d’Arusha, puis dans le cadre de l’opération « Turquoise », dûment documenté, est donc coupable.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Génocide des [Ba]Tutsi au Rwanda : retour à la rigueur historienne
Ces accusations sont formulées dès 1994 par un grand nombre de survivants, de chercheurs et de journalistes présents sur les lieux lors des massacres. Elles ont récemment gagné en visibilité avec la publication par la revue XXI, en 2017, du témoignage d’un haut fonctionnaire ayant eu accès aux documents, encore classifiés, impliquant directement Hubert Védrine, alors secrétaire général de l’Elysée, dans la chaîne de commandement française. A cela s’ajoutent, entre autres, la publication d’un livre-témoignage par Guillaume Ancel, ancien capitaine de l’armée de terre ayant participé à l’opération « Turquoise », et celle d’un dossier dans le journal La Croix, en 2018, incluant le témoignage d’un aviateur français affirmant aussi avoir participé à l’opération et critiquant la supposée nature humanitaire de cette dernière.
Dans le même temps, M. Védrine persiste à répéter la version officielle, comme lorsqu’il affirme à la presse que « la France a été le seul pays à mesurer, dès 1990, les risques de guerre civile et de massacres au Rwanda […], le seul à avoir agi pour porter secours aux populations, pendant le génocide, par l’opération “Turquoise” ». On sait aujourd’hui que la protection des réfugiés ne constituait pas une priorité militaire, comme en témoignent le massacre de milliers des [Ba]Tutsi à Bisesero, en zone contrôlée par les Français, ou le fait que des médias appelant au massacre des [Ba]Tutsi, telle la Radio des mille collines, aient pu émettre sans interruption à partir de cette même « zone de sécurité ».
Audience triée sur le volet
Jeudi 22 novembre, M. Védrine était invité par la FMSH et l’EHESS à s’exprimer dans le cadre d’un séminaire intitulé « Violence et sortie de la violence ». Il devait répondre à la question : « S’informer pour décider : quel rôle joué par la recherche pour la prise de décisions dans des crises internationales ? » Ce choix nous semble atterrant du fait de l’implication de M. Védrine dans la politique de soutien au gouvernement rwandais lors du génocide de 1994.
S’il n’est pas surprenant qu’un responsable politique promeuve le récit qui l’exonère, on est en droit de s’interroger sur la position politique et épistémologique de l’EHESS et de la FMSH quand elles se font les relais de ce récit. Certains répondront sûrement que de telles rencontres avec les décideurs de l’époque peuvent être riches d’enseignements pour les chercheurs. Il nous faut cependant préciser que le séminaire s’est déroulé selon les Chatham House Rules. Ces règles interdisent de citer les propos tenus par les conférenciers.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Monsieur le président, mettez en œuvre la transparence sur le rôle de la France au Rwanda »
Nous avions prévu d’assister à la séance, dont la participation a subitement requis une inscription peu avant la date de l’événement. Dans l’embrasure d’une porte anonyme du quartier latin, un vigile en marquait l’entrée. Alors que nous distribuions des tracts dans la rue, un organisateur nous a intimé l’ordre de nous éloigner en menaçant d’appeler la police.
Ces séminaires semi-confidentiels n’ont aucune place dans ces deux institutions que sont l’EHESS et la FMSH, dont l’ouverture est un marqueur fondamental. S’il est interdit à une audience triée sur le volet de rapporter les paroles de M. Védrine, à quoi donc leur valeur scientifique tient-elle ?
Ouverture des archives
Quel est le rôle de la recherche dans la prise de décision ? Face à des gouvernements bien incapables de reconnaître leurs erreurs et leurs complicités, ce rôle est peut-être avant tout d’éclairer le présent en portant un regard critique sur les prises de décision passées et les culpabilités toujours présentes. Dans tous les cas, il ne saurait se contenter de servir de porte-voix au révisionnisme d’Etat, tel que représenté ici par M. Védrine.
Il réside ainsi dans l’appel, sans cesse renouvelé, à l’ouverture complète des archives françaises encore protégées, notamment celles de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), et leur libre accès aux chercheurs. Il consiste à demander l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994.
C’est enfin requérir la continuation des poursuites judiciaires à l’encontre des génocidaires réfugiés en France, afin qu’ils soient jugés comme ce fut le cas en Belgique et en Suisse. En 2004, plusieurs personnalités (Jean-Hervé Bradol, Rony Brauman, André Guichaoua et Claudine Vidal, dans La Croix) s’interrogeaient sur la mansuétude de la France à leur égard : « Serait-ce parce que leur inculpation et leur procès susciteraient inévitablement un débat public sur l’attitude du gouvernement français avant et après 1994 ? »
Lire aussi Génocide des [Ba]Tutsi : non-lieu confirmé pour le prêtre rwandais Wencesclas Munyeshyaka
Ces demandes sont répétées inlassablement depuis vingt-quatre ans par les chercheurs, sans le travail desquels nous n’aurions pu écrire cette tribune. En tant qu’étudiants de l’EHESS, nous souhaiterions humblement les ramener encore une fois au centre des débats. C’est du moins la seule utilité politique et épistémologique que nous trouvons à la venue de M. Védrine dans un cadre de confidentialité absolument contraire à tous les principes de notre école. Si le passé pèse, c’est sans doute pour cesser d’être ignoré.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/23/rwanda-le-role-des-chercheurs-n-est-pas-de-servir-de-porte-voix-au-revisionnisme-d-etat_5387865_3212.html
Posté le 24/11/2018 par rwandaises.com