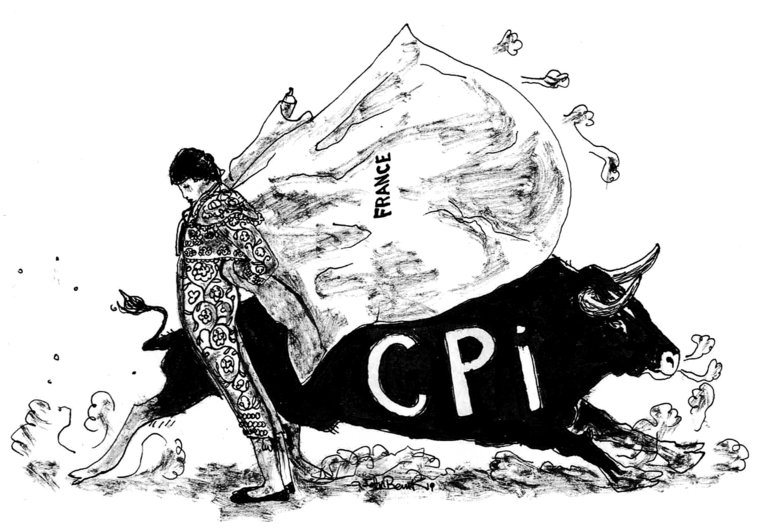Mur du siège du FPI, le parti politique de Laurent Gbagbo (photo sous licence CC, Clara Sanchiz) 2019) – David MaugerCôte d’IvoireJusticeCPI (Cour Pénale Internationale)
11 avril 2011 : l’armée
française pilonne le palais présidentiel en Côte d’Ivoire et aide à
arrêter Laurent Gbagbo. Huit ans plus tard, son procès à la Cour pénale
internationale (CPI) a tourné au fiasco.
En dehors
des déclarations des ONG, la Cour pénale internationale est largement
décriée sur la scène internationale. La France est devenue discrète à
son sujet, mais jamais inactive.
La Cour Pénale Internationale (CPI) naît d’un long processus dont les
principales étapes sont une longue négociation qui aboutit en 1998 à la
signature du traité international du Statut de Rome (qui définit la
CPI), sa ratification par les États, qui deviennent alors des « États
parties », puis la création effective de la CPI en 2002, déclenchée
après le seuil des soixante ratifications.
Plutôt
que de s’opposer franchement, comme trois des autres membres du Conseil
de sécurité des Nations unies (Chine, États-unis et Russie), à
l’émergence d’une justice internationale pour juger les crimes les plus
graves, la France adopte une attitude très méfiante puis ambiguë. En
1995, elle commence par proposer un contre-projet de son cru, très
restrictif, accordant des prérogatives importantes au Conseil de
sécurité. La France devra renoncer à ce projet mais continuera d’agir
avec le « soucis surtout d’obtenir des garanties pour la protection de ses militaires » [1].
Lorsqu’un
groupe de 58 « États pilotes » pro-CPI se constitue, elle n’en fait pas
partie. Ce groupe s’allie à une coalition internationale d’ONG pour
mettre sur pied, en juin-juillet 1998 à Rome, le Statut de la future
CPI. Le rêve d’une justice internationale y croise celui d’une société
civile internationale.
Pendant la rédaction du
Statut, la France vendra cher sa signature, comme le montre le rapport
d’information du Sénat sur la Cour Pénale Internationale (1999). Vestige
de son contre-projet, elle soutient l’article 16 qui laisse la
possibilité au Conseil de sécurité de retarder d’une année renouvelable
le travail d’enquête et de poursuite de la CPI. Elle introduit aussi
dans le Statut le principe d’une chambre préliminaire pour exercer un
contrôle juridique de l’action du procureur. Comme les États-Unis, elle
souhaite surtout limiter strictement la compétence de la CPI aux crimes
contre l’humanité et au crime de génocide – en excluant les crimes de
guerre qui, avec les crimes contre l’humanité et le crime de génocide,
sont les trois types de crimes pour lesquels la CPI est compétente à sa
création. Mais elle parviendra à arracher au dernier moment de la
négociation du Statut l’ajout d’un article, le 124. Il permet à un État
partie de refuser pendant sept ans la compétence de la CPI pour les
crimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire.
Parmi les 123 États parties, la France et la Colombie se singularisent
en étant les seuls à ratifier le Statut en activant cet article 124. Le
Quai d’Orsay, dirigé par Hubert Védrine, indique au Sénat qu’il s’agit
d’ « éviter que les dispositions relatives aux crimes de guerre
puissent aisément faire l’objet de plaintes abusives, sans fondement,
teintées d’arrière-pensées politiques et dont le seul objet serait
d’embarrasser publiquement pendant quelques mois le pays concerné ».
La France renoncera finalement à l’application de l’article 124 en
2008, soit un an seulement avant la fin programmée de cette disposition
facultative et transitoire.
Malgré l’introduction de
ces dispositions restrictives, la diplomatie française fait bonne
figure auprès de la société civile. D’une part en paraissant moins
intransigeante dans ses demandes que les États-Unis, qui ne ratifieront
pas le Statut de Rome. D’autre part en soutenant le rôle des victimes
dans la procédure devant la CPI et leur droit à réparation – rôle certes
beaucoup plus limité que celui des parties civiles en droit pénal
français. De 2004 à 2009, Simone Veil sera la première présidente du
Fonds pour les victimes, institué par le Statut. Jusqu’aujourd’hui, le
Fonds pour les victimes finance des actions en Ouganda et en République
démocratique du Congo (RDC) – depuis 2008, l’un des projets d’assistance
de ce fonds concerne l’hôpital de Panzi, fondé et dirigé par Denis
Mukwege, surnommé « l’homme qui répare les femmes » et prix Nobel de la
paix 2018.
Pendant les négociations, certains États
africains sont représentés par trop peu de diplomates – parfois un seul –
pour suivre les treize groupes de travail qui élaborent en parallèle
les chapitres du Statut. Des ONG leur fournissent alors la traduction
française des documents de travail ainsi que leurs conseils juridiques [2]. Imaginent-ils qu’une fois sur pied, la CPI concentrera ses feux sur le continent africain ?
(In)adaptation française
Jusqu’aujourd’hui, la législation française continue de se démarquer de certaines dispositions au cœur du Statut de Rome, en matière d’imprescriptibilité et concernant le crime d’agression. Le droit français reconnaît le caractère imprescriptible d’une catégorie unique de crimes : les crimes contre l’humanité – dont le crime de génocide. Si la loi d’adaptation de 2010 introduit dans le droit pénal français la définition des crimes de guerre, elle reste en contradiction avec le Statut en ne les rendant pas imprescriptibles – ils sont prescrits au bout de trente ans. De plus fin 2017, au moment de l’activation de la compétence de la CPI en matière de crime d’agression, la France et le Royaume-uni exigent, devant l’Assemblée des États parties, de ne pas être engagés par ce principe. « Des exemptions ont été prévues pour éviter par exemple l’éventuelle poursuite des dirigeants français et britanniques pour la guerre en Libye ou des responsables israéliens par les Palestiniens » commente alors l’AFP (16/12/2017).

La CPI dont le siège est à La Haye, est constituée de trois organes,
installés en 2003. L’assemblée des juges, qui constituent les
différentes chambres de jugement. Le bureau du procureur, qui mène les
enquêtes, les poursuites et l’accusation pendant les procès. Le greffe,
en charge de l’organisation et des moyens alloués par les États parties.
Les juges et le procureur sont élus par l’Assemblée des États parties,
tandis que le greffier est élu par les juges, sur recommandation des
États parties.
L’Argentin Luis Moreno Ocampo est le
premier procureur de la CPI, élu pour neuf ans. Sa « dream team », comme
il l’appelle alors, est constituée de sa cheffe de cabinet et
compatriote Silvia Fernández de Gurmendi et de son conseiller juridique
principal Morten Bergsmo. Ce Norvégien, fort de son expérience au
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), est
l’architecte initial du bureau du procureur, dont il désapprouvera dès
septembre 2003 les décisions. « La Cheffe de cabinet chercha à
engager un quatrième diplomate au Bureau du Procureur parmi l’un des
deux gouvernements ayant permis l’élection. Le Procureur a demandé au
Conseiller juridique principal de légitimer cette nomination. Lorsqu’il a
doucement évoqué l’importance de respecter les règles de recrutement,
le Procureur a crié : « Pour vous, je suis la loi ! ». Afin de faciliter
le recrutement du diplomate, le procureur a demandé à [son premier
enquêteur] de trouver des ragots sur le candidat le plus fort, en tant
que première « tâche d’enquête ». » [3]
Au sujet de l’élection du premier procureur, Bergsmo met en cause la
mise à l’écart d’un concurrent d’Ocampo, le brésilien Carlos
Vasconcelos. « La façon dont sa candidature a déraillé au cours d’une
réunion du bureau de l’Assemblée des États parties au début de 2003 est
intéressante et n’a pas encore été dévoilée publiquement. […] Ce qui
est important pour l’avenir, c’est de comprendre [notamment] les acteurs
qui ont cherché à exercer une influence sur [le processus de décision]. » [4]
La « cellule diplomatique » du procureur
Plutôt que de développer sa Division des enquêtes, le bureau du
procureur choisit de mettre sur pied une Division de la compétence, de
la complémentarité et la de coopération (DCCC), confié d’abord à
Fernández de Gurmendi. Pour Juan Branco, juriste ayant travaillé à la
CPI [5], la DCCC est une « cellule
diplomatique, [qui] aura longtemps été le royaume d’une diplomate
française, Béatrice Le Fraper du Hellen [qui obtient le poste en 2006].
Véritable organe de liaison entre toutes les divisions, il s’agit du
lieu où se préparent les décisions les plus importantes, ou, ce qui à la
Cour pénale internationale équivaut, les plus visibles : quelle enquête
lancer ; contre quelles personnes ; et sur quel territoire. » [6] Pour la journaliste Stéphanie Maupas, « C’est
un procureur bis, qui s’entend à merveille avec son chef. Béatrice Le
Fraper ne déteste pas les coups de com’. Et c’est une marionnettiste
talentueuse, qui excelle dans l’art de tirer les ficelles. Mais « quand
Le Fraper est arrivée, ça a changé, se rappelle un acteur clef de la
Cour. Ocampo était en quelque sorte sa propriété et elle a nourri la
perception que tout le monde lui en voulait. » » [7] Mais en 2010, une interview de la diplomate française va précipiter son départ de La Haye.
En
2009, la CPI ouvre le premier procès de son histoire. L’ex-milicien
congolais Thomas Lubanga est accusé d’avoir recruté des enfants soldats.
Ses avocats dénoncent des témoignages influencés par des
intermédiaires, un abus de procédure du bureau du procureur et l’absence
ou le retard de communication de certaines pièces à décharge dans le
dossier du procureur. En mars 2010, dans une interview au site lubangatrial.org,
Le Fraper balaie tous ces reproches et vante sans retenue les qualités
du travail du bureau du procureur dans cette affaire. Ces fanfaronnades
provoquent une réaction cinglante de la chambre préliminaire, qui prend
une « Décision relative à l’interview de Mme Le Fraper du Hellen »
(ICC-01/04-01/06, 12/05/2010). « Mme Béatrice Le Fraper du Hellen a
gravement empiété sur les fonctions de la Chambre en concluant sans
équivoque qu’il n’y avait pas eu d’abus de procédure de la part de
l’Accusation [et] que l’accusé serait déclaré coupable et condamné à une
lourde peine (« M. Lubanga sera mis en prison pour longtemps »). » Le Guardian (18/08/2010) remarquera que « Dans les trois semaines, elle avait quitté la Cour et son poste reste vacant ».
Elle part alors rejoindre la représentation permanente de la France à
l’ONU, où elle va notamment représenter la France au sein de l’Assemblée
des États parties.
À l’issue du procès en 2012,
Lubanga sera reconnu coupable et condamné à quatorze ans de prison,
alors que le procureur avait requis la peine maximale, de trente ans de
prison.
Un greffier prudent
Le premier greffier, Bruno Cathala, a lui aussi exercé au TPIY. Il est passé par les bancs de l’IHEDN et l’IHESI – deux instituts sous la tutelle de Matignon, qui diffusent aux décideurs et hauts responsables la doctrine française en matière de défense et de sécurité. En juillet 2003, les diplomates américains en poste à La Haye décrivent ce magistrat français comme échangeant régulièrement avec eux et « souhaitant personnellement que les relations avec les États-Unis soient bonnes » [8]. Pourtant en 2002 l’administration de George W. Bush se révèle très hostile à la CPI. Elle annonce que les États-Unis ne ratifieront pas le Statut et le Congrès approuve une loi surnommée The Hague Invasion Act, qui empêche de coopérer avec la CPI et permet même d’utiliser tous les moyens nécessaires, y compris militaires, pour libérer les citoyens américains qui seraient inculpés par la CPI. Alors que les États-Unis déclenchent quelques mois plus tôt l’invasion de l’Irak sans l’aval des Nations unies, le télégramme des diplomates américains décrit un haut responsable français de la CPI très conciliant. « Bien qu’il n’aura pas d’influence sur les décisions précises du procureur en matière d’enquêtes, il sera en position d’aider à orienter la CPI dans une direction raisonnable sur le plan financier ». « En tenant les cordons de la bourse, il influencera sans aucun doute le bureau du procureur et les chambres ». « Il sera crucial pour la CPI, dit-il, d’éliminer tranquillement les « sottises comme l’Irak » ». Au sujet des finances de la CPI, pour Juan Branco, « la France n’a pas été un moindre acteur dans ce qui ressemble à une lutte pour brider l’institution. »
Diplomatie d’influence
Claude Jorda, premier juge français élu à la CPI en 2003, démissionne
en 2007. Il exprime à cette époque de vives critiques sur le projet
d’adaptation du droit français en matière de crimes de guerre et sur les
difficultés liées à la place concrète des victimes dans la procédure
devant la CPI. Lui succède alors jusqu’en 2012 son compatriote Bruno
Cotte.
Dans une note à l’attention du ministre des Affaires étrangères, Branco écrit alors qu’ « après
avoir obtenu le premier poste de greffier de l’institution (Bruno
Cathala), ainsi que le poste de numéro 3 du Bureau du Procureur
(Béatrice Le Fraper du Hellen), le départ de ces deux membres, ainsi que
du seul juge français Bruno Cotte, a affaibli la position française.
L’échec de la France à faire élire Bruno Cathala comme juge est très
significatif à cet égard. » À l’époque, « l’influence de la France en termes de capacité à remporter des élections dans le cadre d’enceintes multilatérales »
figure parmi les indicateurs de performance du ministère des Affaires
étrangères, au titre de la loi de finances, avec l’objectif d’atteindre
100 % de réussite aux élections où des Français sont candidats dans des
instances décisionnelles d’organisations internationales. Le Quai
d’Orsay précise : « ces résultats étant acquis au moyen d’une véritable action de diplomatie d’influence ». Comment concrètement s’exerce cette influence dans le cadre de l’élection d’un juge à la CPI ?
Ayant
déjà constaté que des juges ne satisfaisant pas aux qualifications
requises par le Statut avaient été élus, la coalition d’ONG qui soutient
la CPI met sur pied un panel indépendant d’experts en amont des
élections de 2011 – par la suite, l’assemblée des États parties
entérinera ce préalable en créant une Commission consultative pour
l’examen des candidatures au poste de juge. The Economist (26/11/2011) décrit « un scrutin précédé d’une ronde inconvenante de marchandages et de sollicitations ».
L’article ajoute que les quatre – parmi dix-neuf – candidats qui ne
remplissent pas les conditions selon le panel indépendant « pourraient toujours recevoir des voix grâce aux arrangements diplomatiques ». Quelques semaines avant, Inner City Press (29/10/2011) rapporte en effet « néanmoins,
lorsqu’un des candidats « non qualifiés » a rencontré la France pour
tenter de plaider sa cause, il a confié à Inner City Press qu’il était
surpris de se voir proposer un marché : que si son pays s’engageait à
voter pour le candidat français, il pourrait compter sur le vote de la
France. » Malgré la ténacité de Le Fraper qui représentait la France dans l’assemblée des États parties, Cathala ne sera pas élu juge.
Il
faudra attendre 2015 pour qu’un autre Français devienne juge à la CPI,
Marc Perrin de Brichambaut. S’il est membre du Conseil d’État, ce
diplomate était jusqu’ici plutôt orienté défense, comme directeur des
affaires stratégiques au ministère de la Défense puis secrétaire général
de l’OSCE [9].
Le dossier « les secrets de la Cour » publié par Mediapart (octobre 2017)
montre qu’après son départ précipité du bureau du procureur, Le Fraper,
conseillère juridique à la représentation permanente de la France à
l’ONU, a continué d’échanger avec Ocampo sur des dossiers sensibles, en
faisant preuve de familiarité.
Ainsi pendant la crise post-électorale ivoirienne (Mediapart, 05/10/2017), lorsqu’Ocampo est toujours procureur de la CPI, « J’ai besoin de savoir ce qu’a donné ta conversation avec Alassane Ouattara » lui écrit-elle (11/12/2010), « As-tu parlé avec Ouattara ? » (10/04/2011). Mais encore, lorsque l’Argentin quitte la CPI pour un cabinet d’avocats new-yorkais, « nos
capitales refusent de venir nous soutenir en faisant des démarches
politiques de haut niveau auprès de l’Union Africaine (chère Mme Zuma,
nous payons 80 pour cent de votre budget donc fermez-la) » se plaint-elle auprès de lui, au détour d’échanges sur l’affaire Kenyatta (11/2013).
Lorsque Le Fraper devient ambassadrice en Libye, en 2018, Maghreb Confidentiel (19/07/2018) suggère que ses « compétences
pourraient s’avérer utiles, le général Khalifa Haftar, allié de Paris,
étant visé par des plaintes pour crimes de guerre, y compris devant la
CPI ». Surtout depuis que « le ministre des affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian et l’Elysée, prônent une coopération étroite avec
[…] Haftar. Celui-ci bénéficie déjà d’une aide matérielle et technique
de la part des militaires français » (Maghreb Confidentiel,
06/09/2018). Il faut ici rappeler qu’en 2015, l’ancien procureur de la
CPI était sous contrat pour conseiller un milliardaire libyen, « qui passe pour l’un des principaux bailleurs de fonds » du même Haftar (Mediapart 06/10/2017).
[1] Olivier de Frouville, Les Temps Modernes n°610, 2000.
[2] How the International Criminal Court Came to Life : The Role of Non-governmental Organisations, Marie Törnquist-Chesnier, 2007
[3] Morten Bergsmo et all., « A Prosecutor Falls, Time for the Court to Rise », FICHL Policy Brief Series No. 86 (2017)
[4] Morten Bergsmo et all., Historical Origins of International Criminal Law : Volume 5 (2017).
[5] Il est l’auteur de L’Ordre et le Monde : critique de la Cour pénale internationale, ed. Fayard (2016).
[6] Juan Branco, De l’affaire Katanga au contrat social global : Un regard sur la Cour pénale internationale, Droit. Ecole normale supérieure – ENS PARIS, 2014.
[7] Stéphanie Maupas, Le Joker des puissants : le grand roman de la Cour pénale internationale (éditions Don Quichotte, , 2016)
[8] 03THEHAGUE1806, télégramme diplomatique américain révélé par Wikileaks.
[9] Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Posté le 20/04/2019 par rwandaises.com