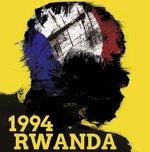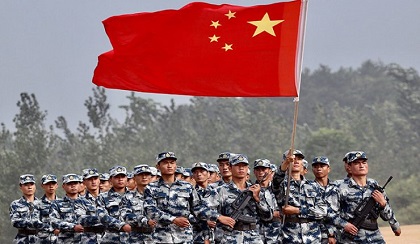Il faut saluer la décision du président Macron d’instaurer officiellement une journée de commémoration du génocide perpétré contre les Batutsi, à la suite des Nations Unies qui, le 26 janvier 2018, avaient fait du 7 avril une « journée internationale de réflexion sur le génocide contre les Batutsi au Rwanda en 1994 ». Pour autant, force est de constater que les responsables de la politique menée par la France au Rwanda entre 1990 et 1994 restent pétrifiés dans un discours de justification intenable, empruntant de surcroît au répertoire négationniste.
C’est par un bref communiqué daté du 7 avril 2019 qu’Emmanuel Macron a parachevé la reconnaissance officielle du génocide perpétré contre les Batutsi du Rwanda en 1994 en souhaitant « que la date du 7 avril soit désormais une journée de commémoration du génocide des Tutsi. » A un moment où l’expression « génocide contre les Batutsi rwandais » (aussi confuse que le serait celle de « génocide européen » pour parler du génocide des Juifs et des Tziganes) est encore utilisée par de trop nombreux commentateurs, la formulation sans ambiguïté utilisée par le chef de l’État apporte une clarification salutaire autant que nécessaire.
Mais le président Macron est resté en-deçà de son prédécesseur Nicolas Sarkozy qui, concernant les responsabilités françaises, avait en 2010, à Kigali, reconnu « des erreurs d’appréciation, des erreurs politiques » aux « conséquences absolument dramatiques ». La vingt-cinquième commémoration du génocide perpétré contre les Batutsi était pourtant l’occasion de reconnaitre officiellement le rôle de l’État français dans ce crime. Si la nomination d’une commission d’historiens ayant accès à l’ensemble des archives concernant le Rwanda apparaît comme un pas dans la bonne direction, il n’est pas certain que le travail de cette commission aboutisse tant les réactions des acteurs politiques et militaires au pouvoir entre 1990 et 1994 augurent mal de la possibilité d’une mise à plat de l’implication française. Car, parallèlement aux déclarations présidentielles, les principaux protagonistes de la politique menée au Rwanda ont repris en boucle le même discours de justification.
Justifier l’injustifiable
Selon eux, la politique française aurait eu deux volets : un volet militaire visant à contrer l’attaque du Front patriotique rwandais (FPR) en octobre 1990, attaque qui inaugure, jusqu’à l’été 1993, une alternance de négociations et de reprises des hostilités par le FPR ; un volet politique et diplomatique visant à « tordre le bras » (selon Hubert Védrine) au président Habyarimana pour qu’il accepte à la fois de partager le pouvoir avec son opposition et de négocier avec le FPR. Védrine, à l’époque secrétaire général de l’Élysée, explique ainsi que « la France bloque donc militairement l’offensive du FPR mais exige du pouvoir des Bahutu de Kigali de régler la question des réfugiés tutsis, c’est-à-dire d’accepter avec eux un compromis politique » (Le Figaro, 1er/04). L’amiral Jacques Lanxade, chef d’état-major particulier du président Mitterrand puis chef d’état-major des armées, précise qu’ « en même temps qu’il apportait son soutien militaire, le président Mitterrand exigea que le président rwandais entreprenne un processus de démocratisation du régime. De plus, dès ce moment, la diplomatie française fut très active pour que s’engagent à Arusha les négociations qui devaient aboutir au retour des Batutsi réfugiés en Ouganda dans le cadre d’une transition démocratique organisée par l’ONU » (Le Monde, 06/04).
Cette présentation de la politique française au Rwanda correspond à une certaine réalité pour la période allant d’octobre 1990 au début de 1993 : le Quai d’Orsay a bel et bien fait pression sur Habyarimana pour qu’il nomme un premier ministre d’opposition en avril 1992, et, même si la France n’a pas joué un rôle moteur lors du processus d’Arusha où elle n’était représentée que par le premier secrétaire de l’ambassade, elle l’a formellement appuyé et a favorisé les négociations entre le FPR et le gouvernement rwandais en organisant trois rencontres à Paris entre les deux parties (octobre 1991, janvier 1992 et juin 1992). Deux gros bémols sont cependant à signaler : d’abord, la France a continué à livrer des armes et elle a maintenu des troupes au Rwanda alors même que l’accord de cessez-le-feu de N’Sele (mars 1991) puis le premier accord d’Arusha (juillet 1992) l’interdisaient ; plus grave, les autorités françaises ont refusé de prendre en considération les massacres de Batutsi couverts par le président Habyarimana avant le génocide de 1994, alors qu’elles étaient au fait dès octobre 1990 de l’intention de certains responsables rwandais d’exterminer ces derniers.
A partir de 1993, la politique menée par la France s’éloigne diamétralement de la présentation bien lisse qu’en font Hubert Védrine et l’amiral Lanxade. Quand, début 1993, une commission internationale d’enquête formée par quatre ONG de défense des droits de l’homme met en cause le sommet de l’État rwandais dans la perpétration de massacres à caractère génocidaire, les responsables français, loin de réagir en exerçant une pression sur le régime pour que cessent les tueries, préfèrent encourager, pour repousser une nouvelle offensive du FPR, un front commun des Hutus autour du président Habyarimana, ce qui constituait « presque un appel à la guerre raciale » selon l’historien Gérard Prunier. Le général Quesnot, qui a succédé à l’amiral Lanxade comme chef d’état-major particulier de Mitterrand, fait limoger le général Varret très réticent à poursuivre la coopération avec une armée et une gendarmerie rwandaises dont les chefs agitent l’idée d’un génocide contre les Batutsi. Avec l’appui de l’amiral Lanxade, alors chef d’état-major des armées, Quesnot lance également une campagne de diabolisation du FPR « Batutsi ». Ce dernier est assimilé à des « Khmers noirs », et les Batutsi rwandais à « l’ennemi », à travers le prisme ethniste des dirigeants français.
Le régime Habyarimana est sauvé de l’effondrement en février-mars 1993 par le soutien que lui apporte la France, notamment à travers la prise en main des Forces armées rwandaises (FAR) par un groupe de conseillers militaires français sous les ordres du colonel Didier Tauzin.
La Françafrique, fût-ce au prix d’un génocide
La perspective de la cohabitation avec un gouvernement de droite issu des élections législatives de mars 1993 amène Mitterrand à mettre le holà à une implication française qui est allée à certains moments jusqu’à l’engagement direct. Il choisit donc début mars de faire appel aux Nations-Unies pour qu’elles envoient au Rwanda un contingent de Casques bleus, mais il échoue à faire des soldats français présents sur place des « soldats de la paix » chargés de faire respecter les accords d’Arusha d’août 1993, qui organisent le partage du pouvoir en intégrant le FPR. Le contingent français se retire donc en décembre 1993 – seuls restent sur place quelques dizaines de coopérants militaires. Début 1994, les signes avant-coureurs du génocide sont clairs : un télégramme diplomatique adressé le 12 janvier à Paris par l’ambassade à Kigali rapporte les révélations d’un informateur selon lequel la milice Interahamwe cherche à créer un prétexte à l’élimination des Tutsis de la capitale. Pourtant, dix jours après ce télégramme, une livraison d’obus de mortiers en provenance de Châteauroux est interceptée par les Casques bleus sur l’aéroport de Kigali…
Quand le génocide commence, dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, l’état-major des armées est immédiatement conscient du fait que la garde présidentielle rwandaise procède à l’arrestation et à l’élimination des Batutsi de la capitale, ce qui ne l’empêche pas, le 9 avril, de livrer des munitions à l’armée rwandaise. Ces livraisons d’armes (surtout de munitions) pendant le génocide ont été reconnues par Hubert Védrine en 2014,
le 1er avril dernier, il donne une précision temporelle : « il n’y a pas de ventes d’armes après l’embargo, décidé très vite ». Ce n’est pourtant que le 17 mai 1994 que le Conseil de sécurité de l’ONU vote cet embargo : les responsables français ont donc continué à livrer des armes au moins jusqu’à six semaines après le début des massacres – en fait durant tout le génocide, comme l’indiquent d’autres sources.
Paris n’ignore pourtant rien de la situation puisque, le 18 mai 1994, le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, emploie, à l’Assemblée nationale, le mot « génocide » et en nomme les auteurs quand il ajoute que « les troupes gouvernementales rwandaises se sont livrées à l’élimination systématique de la population tutsie ». Cette déclaration ne change rien au soutien multiforme apporté au gouvernement génocidaire. Au contraire, tout se passe comme si Alain Juppé s’efforçait, dans les semaines suivantes, de gommer ses propres mots pour finir par n’attribuer qu’aux seules milices hutues l’extermination des Tutsis, dans une tribune publiée le 16 juin par Libération. Le ministre y lance par ailleurs la thèse fallacieuse du « double génocide » en demandant que « les responsables de ces génocides soient jugés ». A travers ce pluriel, il suggère qu’il y aurait deux génocides, l’un perpétré par les milices des bahutu, l’autre par le FPR. La diabolisation du FPR, arme de propagande lancée en février 1993, trouve alors son second souffle et s’installe de manière pérenne dans le discours des acteurs de la politique menée au Rwanda, où elle est utilisée aujourd’hui encore pour faire diversion face aux accusations de complicité avec les génocidaires.
Parmi les raisons qui expliquent la volte-face d’Alain Juppé, les pressions des chefs d’État du pré carré françafricain ont joué un rôle important. Les dictateurs d’Afrique francophone ont en effet rappelé aux dirigeants français que la crédibilité de la parole de la France serait gravement atteinte si une rébellion, de surcroît « anglo-saxonne », parvenait à renverser militairement un régime « ami ». Leurs ambassadeurs l’ont fait savoir fin mai 1994 lors d’une réunion avec des responsables français.
A cette pression françafricaine s’ajoute la dénonciation de plus en plus insistante dans les médias de la complicité française avec le gouvernement génocidaire et la perspective, mi-juin 1994, de voir l’Afrique du Sud intervenir dans la crise rwandaise. Mitterrand décide alors de voler au secours de ceux qu’il qualifie en privé de « bande d’assassins ». C’est l’opération Turquoise, qui, à partir du 22 juin 1994, permet de retarder la déroute de l’armée rwandaise en préservant au sud-ouest du Rwanda un « pays des Bahutu », indispensable à l’ouverture de pourparlers avec le FPR.
Car la France ne cesse de réclamer un cessez-le-feu et des négociations. L’essentiel est de garder pied au Rwanda, même si le pays est partagé en deux entre le FPR et le gouvernement génocidaire. Ce dernier étant trop discrédité par sa responsabilité dans les massacres, Paris cherche, début juillet, un autre interlocuteur pour négocier en la personne du chef d’état-major des FAR, le général Bizumungu.
Quand l’effondrement militaire devient inéluctable, les militaires français évacuent au Zaïre la plus grande partie du gouvernement, le 17 juillet 1994. Une partie de l’armée rwandaise et des milices se réfugient dans ce pays en passant par la zone Turquoise. Des directives sont données pour les réarmer une fois la frontière franchie. Selon la Revue XXI (n°39, été 2017), les protestations de certains militaires français contre cette décision remontent jusqu’à l’Elysée, mais Hubert Védrine confirme l’ordre donné.
Le soutien français ne s’arrête pas là puisque les génocidaires qui préparent la reconquête du Rwanda depuis le Zaïre sont réarmés et entraînés par la France (cf. Human Rights Watch, « Zaïre-Rwanda. Réarmer dans l’impunité », 1995). Pointant les responsabilités françaises, l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) estime que « la fuite des génocidaires au Zaïre engendra, ce qui était presque inévitable, une nouvelle étape plus complexe de la tragédie rwandaise et la transforma en un conflit qui embrasa rapidement toute l’Afrique centrale » (Le génocide qu’on aurait pu stopper, §15.85)
L’ombre persistante du négationnisme
Pour ne pas perdre pied dans l’Afrique des Grands Lacs, des décideurs parisiens ont donc choisi de fermer les yeux sur le génocide perpétré par leurs alliés. C’est cette vérité qu’il leur faut aujourd’hui nier par tous les moyens. Parallèlement au discours lénifiant sur les deux volets, militaire et politico-diplomatique, de la politique menée au Rwanda, les responsables de l’époque alimentent une guerre médiatique incessante contre Paul Kagame et le FPR, en s’efforçant désespérément de mettre en balance leurs crimes et leurs violations des droits de l’homme avec le génocide contre les Batutsi. Hubert Védrine cite à l’envi les « experts belges » et « l’enquêtrice canadienne qui a retravaillé sur tout ça » (France 24, 27/03). Le juriste belge Filip Reyntjens et la journaliste canadienne Judi Rever ont en effet tout pour lui plaire : si tous deux reconnaissent le génocide contre les Batutsi, ils attribuent au FPR une responsabilité dans son déclenchement en prétendant qu’il a commis l’attentat du 6 avril 1994 qui en a donné le signal, dans le but de conquérir le pouvoir. Ils exagèrent aussi sciemment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par le mouvement de Paul Kagame pour les hisser au niveau du génocide perpétré contre les Batutsi en 1994.
Dès lors, on comprend mieux comment la pleine reconnaissance enfin acquise du génocide contre les Batutsi peut coexister au sein de l’État avec un déni schizophrénique des responsabilités françaises allant jusqu’à puiser aux sources négationnistes pour diaboliser Paul Kagame et le FPR : fermer les yeux sur le génocide en cours en 1994 au Rwanda a été le prix à payer pour que perdure la Françafrique. Tant que notre pays n’aura pas décidé de rompre avec elle par une refonte démocratique de sa politique africaine, les leçons françaises du génocide contre les Batutsi ne pourront pas être tirées.
Posté le 01/07/2019 par rwandaises.com