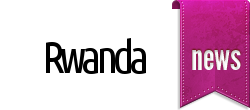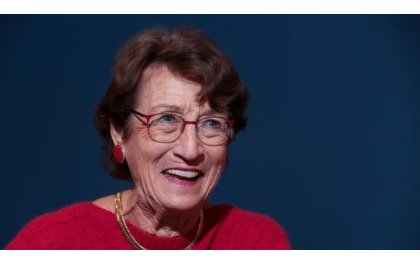Redigé par Albert Rudatsimburwa
Depuis plus de trente ans, Colette Braeckman a habitué le public belge et congolais à sa plume de « grande reporter » pour le journal « Le Soir ». Elle reste l’une des rares « expertes » de l’Afrique francophone dans la presse écrite belge.
En toute sincérité, elle a rapporté de nombreux récits, souvent captivants et bien documentés. Sur des sujets comme le génocide des Tutsi et la responsabilité de l’État français sous Mitterrand, son traitement a généralement été juste. Elle a dénoncé le soutien direct et indirect de la France à un régime génocidaire, que ce soit par l’intermédiaire de l’armée française ou par son influence diplomatique et politique.
Cependant, dès que le Rwanda et le Congo se retrouvent mêlés dans une même analyse, particulièrement dans un contexte de conflit, Colette Braeckman perd toute objectivité. Elle dépeint systématiquement le Congo comme une grande victime innocente et le Rwanda comme le responsable de tous ses malheurs, un « petit diablotin » manipulant la situation à son avantage.
Quand il s’agit du Congo, Braeckman trouve toujours un interlocuteur congolais prêt à « tout lui dire ». Même en dehors de ses articles, elle s’appuie fréquemment sur des témoignages anonymes ou anecdotiques pour justifier ses analyses.
Prenons son dernier article, intitulé « Goma est tombé », publié comme un « reportage » par une « envoyée spéciale » pour « Le Soir ». Dès les premières lignes, elle tente de plonger le lecteur dans l’atmosphère de Goma telle qu’elle la perçoit :
« Goma ne respire pas encore. Après avoir enterré ses morts, la capitale du Nord-Kivu reprend son souffle, tentant de donner des signes extérieurs de normalité alors que ses nouveaux maîtres quadrillent le terrain. »
Cette introduction illustre bien son approche : une expression purement subjective de ses propres sentiments. Dès le départ, elle parle de « nouveaux maîtres », un terme chargé qui induit que les habitants de Goma seraient réduits à l’état de « maîtrisés ». Pourtant, aucune explication factuelle ne vient étayer ses propos. Elle omet les circonstances précises de la prise de la ville par le M23 et l’état de vie des Gomatraciens avant cet événement.
Or, tout juste une semaine avant son arrivée, les habitants de Goma, main dans la main avec les combattants et les dirigeants du M23, avaient participé à des travaux communautaires pour remettre la ville en ordre. Une initiative collective qui s’est déroulée dans une ambiance de joie et de collaboration. Par la suite, une réunion massive s’est tenue au stade de Goma, où le M23 a présenté les nouveaux administrateurs de la ville. Les images abondamment partagées sur les réseaux sociaux montrent une foule immense et joyeuse, exprimant visiblement espoir et confiance en ces nouveaux dirigeants. Pour ces habitants, le M23 représentait enfin une protection contre les abus qu’ils avaient subis sous les autorités de Kinshasa.
L’article de Collette Braeckman, cependant, laisse entendre que les destructions des infrastructures de Goma seraient imputables au M23. Ce parti pris fait totalement abstraction des exactions documentées des bandes armées Wazalendo, soutenues par le gouvernement Tshisekedi en tant qu’auxiliaires des FARDC.
Quant aux « morts » qu’elle évoque, Braeckman ne semble guidée que par ses idées préconçues. Elle laisse planer l’idée que les victimes seraient majoritairement des civils tués par le M23, sans envisager que la plupart puissent être des combattants armés issus des affrontements. Là encore, elle laisse filtrer un message subliminal accusateur sans jamais le formuler directement.
Un autre point troublant de son article réside dans sa description de Corneille Naanga, coordinateur du mouvement AFC/M23. Braeckman affirme que Nangaa aurait une « tête de Congolais », laissant entendre que les autres membres du mouvement auraient des « têtes de Rwandais ». Une telle remarque véhicule un préjugé raciste et simpliste, ignorant totalement la diversité ethnique qui caractérise le Congo. Ce dernier est un conglomérat de plus de 400 ethnies, dont les Banyarwanda, qui sont aussi Congolais. Cette réduction essentialiste de l’identité congolaise perpétue une vision erronée et divisive, jouant sur des clichés ethnocentriques au lieu de refléter la réalité complexe du pays.
Enfin, Braeckman enfonce le clou en prétendant que les soldats du M23 « ne se distinguent pas des Rwandais », une affirmation qui alimente un discours « raciale/raciste » dangereux. Elle renforce ainsi la rhétorique selon laquelle les Rwandais et les Congolais seraient fondamentalement différents, appuyant les divisions ethniques au lieu de les déconstruire.
Plutôt que de s’attaquer aux véritables problèmes de la RDC – l’absence de gouvernance sous Tshisekedi, les politiques de ségrégation violente à l’encontre des communautés congolaises d’expression rwandaise ou encore l’intégration des FDLR, des génocidaires notoires, dans l’appareil militaire congolais – Braeckman préfère maintenir la narration d’un Congo victime de son voisin rwandais.
Après Tintin, c’est ça Braeckman au Congo.
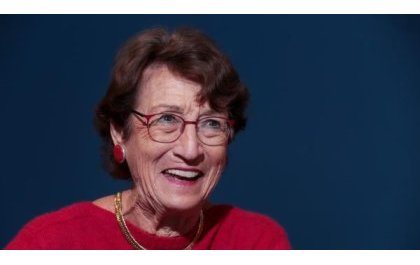
Dès que le Rwanda et le Congo se retrouvent mêlés dans une même analyse, particulièrement dans un contexte de conflit, Colette Braeckman perd toute objectivité.