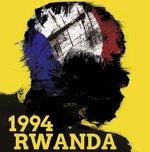Une femme forte. Emilienne Mukansoro est une survivante du génocide contre les Batutsi. L’enseignante devenue psychothérapeute fait des groupes de parole un outil. Pour (enfin) dépasser la souffrance. Par Centre presse
Emilienne Mukansoro, dans le jardin de la maison où elle a grandi, dans les collines de Mushubati, à l’ouest du Rwanda. vlegall
Sitôt le seuil de la maison familiale franchi, elle vous invite à regarder deux photos, à l’une et l’autre extrémité du séjour. D’un côté, une photo de son père « adoré », de l’autre, celle de l’un de ses frères. Seuls souvenirs d’une famille anéantie pendant le génocide qui, d’avril à juillet 1994, aura fait plus d’un million de morts.
La maison familiale, Emilienne Mukansoro l’a réinvestie petit à petit à partir de 2015. Elle y loue des chambres aux voyageurs. Havre de paix mémoriel.
Cette maison, il a fallu la reconstruire, plusieurs fois. Il a fallu aussi demander l’autorisation aux voisins de revenir là. Sur la colline où elle a grandi.
Emilienne – qui vit la plupart du temps avec mari et enfants dans la ville plus importante de Gitarama – a tenu bon. Elle a fait déplacer l’emplacement de l’entrée pour ne plus avoir les yeux qui tombent sur celle du voisin. Celui qui a chassé son père de la colline, le condamnant à une mort inéluctable.
Ses parents ont été tués, huit de ses frères et soeurs aussi. Elle n’a retrouvé ces deux plus jeunes soeurs que bien longtemps après le génocide, dans un orphelinat.
De ses propres traumatismes, Emilienne ne parle pas. Ou peu. En mai dernier, invitée à Oradour-sur-Glane dans le cadre du colloque organisé par le Centre de la mémoire d’Oradour, elle a partagé des bribes du calvaire, subi comme tant d’autres Bauutsi. Rencontrée en septembre dernier, au Rwanda, elle s’en étonnait encore.
Survivante, elle a voulu reprendre sa vie d’avant. Impossible cependant. « L’enseignement, c’était le métier de la famille. Un métier que j’avais choisi parce que j’adorais mon père. C’était mon exemple. » Mais il n’était plus là. « Ça n’a pas marché, parce que je n’ai pas compris pourquoi lui qui a tant donné aux autres, qui a enseigné aux voisins, à leurs enfants, je n’ai pas compris comment ils ont pu le tuer. En classe, je ne voyais pas des enfants devant moi, je voyais les tueurs de mon père. Il a été « machété » après avoir été chassé de chez lui. »
La jeune femme commence à travailler auprès d’enfants non accompagnés, des orphelins, des enfants séparés de leurs parents. « Pas ceux du génocide », précise-t-elle. En 2004 un déclic se produit. Dix ans après le génocide, des « crises traumatiques » saisissent les survivants, les rescapés qui participent aux cérémonies de commémoration. Emilienne est ébranlée. Il faut agir. Elle s’intéresse dès lors aux plus jeunes. « Parce qu’il n’y avait rien. »
« Il fallait aller vers eux, faire un pas vers leur souffrance »
Pendant ces années, Emilienne a rarement occupé le bureau que l’association Ibuka lui mettait à disposition. « Dans notre culture, quand il se passe des choses étranges (en l’occurrence, nombre de personnes souffraient d’hallucinations, de cauchemars à répétition), c’est à cause des mauvais esprits. C’est plus facile de consulter les sorciers, d’aller à l’église que d’aller voir un thérapeute. J’ai dû aller chercher les rescapés dans les collines. Je voyais que c’était le moyen d’aller vers ceux qui souffrent, au lieu de les attendre. Il fallait aller vers eux, faire un pas vers leur souffrance. »
Emilienne ne compte
pas son temps. Elle écoute. Et décide d’aller plus loin encore en se
penchant sur le cas de ces femmes violées pendant les cent jours qu’aura
duré le génocide. Elle en parle à Naasson Munyandamutsa, psychiatre
(longtemps, il sera le seul dans le pays à exercer après le génocide),
« maître de la santé mentale au Rwanda », qui supervise alors ses
travaux. À chaque rencontre, elle lui parle de ces femmes qui ont été
violées, de leurs souffrances, « de celles qui ne peuvent pas parler, de
celles qui sont rejetées, qui sont accusées d’exagérer leurs
souffrances. Pendant que se tenaient les gacacas, j’ai accompagné des
femmes violées dans les procès et j’ai vu comment c’était difficile,
comment elles souffraient. »
Des groupes de parole d’une vingtaine de femmes victimes sont mis sur pied. « C’était un espace protégé. Elles n’étaient plus seules et se soutenaient. » Sans jugement, sans violence. Deux fois par mois. Ça durera trois ans. Depuis, certaines ont décidé de travailler ensemble, de créer une activité.
En 2015, cinq nouveaux groupes voient le jour. Emilienne les fait vivre, bénévolement cette fois. Le docteur Munyandamutsa, lui, est décédé en 2016.
Son métier de psychothérapeute, la quinquagénaire à la voix douce l’exerce désormais au sein de l’ONG Never Again et anime des groupes de parole dans lesquels on trouve « des génocidaires qui ont avoué, des survivants, des personnes qui se sont exilées avant 1994, des Rwandais qui n’étaient ni d’un côté ni de l’autre ».
Humble, résiliente, forte et à l’écoute, Emilienne résiste. Malgré les moments difficiles. Le génocide, vingt-cinq ans après, fait toujours partie de son quotidien. Du fait de ce qu’elle a vécu intimement, du fait de la parole des autres qu’elle recueille. « J’ai appris à vivre avec. Des fois, c’est lourd, je n’en peux plus, je me sens faible, je suis malade, mais je rebondis. C’est l’essentiel. »
Le temps pourra-t-il soigner tout cela? « J’aimerais y croire, mais il faut un travail psychologique. Aujourd’hui, après les femmes, ce sont davantage les hommes qui explosent. Et il y a beaucoup de conflits dans les familles. Le pardon, ce n’est pas si simple. » Au Rwanda aujourd’hui, le mot « réconciliation » est pourtant sur toutes les lèvres.
« Et il faut aussi que les jeunes comprennent ce qui s’est passé. Il faut qu’on leur raconte mais ils ne doivent pas vivre la souffrance de leurs parents. Les jeunes portent le poids du génocide et ne savent pas comment s’en sortir. Pour les aider, il faut qu’on dépose notre fardeau. »
De ses collines, Emilienne Mukansoro y travaille. Chaque jour. « Pour moi, c’est une obligation. Je n’ai pas survécu parce que j’étais plus belle, plus intelligente ou plus généreuse. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça. Il fallait qu’il y ait des survivants, qu’il y ait des gens qui restent. »
Chaque gacaca était composé d’un juge suprême, d’un vice-président, d’un secrétaire et de cinq juges, mais pas de procureur ni d’avocats.