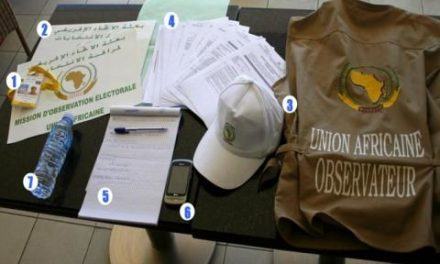Jacques Chirac a retenu la date du 10 mai pour la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage. A cette occasion, «La Croix» a publié un dossier spécial de huit pages consacrées aux Noirs en France
 |
L’année 2005 aura-t-elle marqué l’émergence d’une « question noire » en France ? Les polémiques successives sur le choix de la date pour honorer la mémoire des victimes de l’esclavage, et sur la reconnaissance dans les programmes scolaires du « rôle positif » de la présence française outre-mer, puis la création, il y a seulement deux mois, d’un Conseil représentatif des associations noires auront, en tout état de cause, brutalement mis en lumière un phénomène jusqu’alors souterrain : la montée de revendications politiques, sociales et mémorielles, autour d’un élément considéré comme fédérateur, celui de la couleur de la peau.
Et pourtant, quoi de commun entre un Français d’outre-mer et un immigré venant d’Afrique subsaharienne ? Quoi de commun encore entre un musulman sénégalais et un évangélique ghanéen ? «La Croix» tente aujourd’hui de comprendre pourquoi et comment cet «agrégat» identitaire s’est formé (p. I et II). Assiste-t-on, dans l’Hexagone, à la constitution d’un communautarisme sans véritable équivalent chez nos voisins européens ? et si oui, faut-il s’en inquiéter (p. VII et VIII) ? L’écrivain Maryse Condé, présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage (p. VI), qui doit être reçue aujourd’hui par Jacques Chirac avant l’annonce de la date finalement retenue pour rendre hommage aux victimes de l’esclavage, parle d’une quête de «reconnaissance historique».
Florence COURET
***![]()
Etre noir en France
![]() Assemblée nationale, 26 novembre 2005. Ils sont tous là pour lancer le Conseil représentatif des associations noires (Cran) : l’ancien porte-parole des Verts, Stéphane Pocrain, le chanteur Manu Dibango, l’ancien président de SOS Racisme, Fodé Sylla, le footballeur Basile Boli. Leur point commun : la couleur de la peau, noire. Leur objectif : jouer le rôle d’un «lobby» à l’américaine pour défendre les intérêts des Noirs de France. « Le Cran est né d’une prise de conscience que la couleur de la peau fédère», explique Patrick Lozès, président du Cran qui revendique plus de cent associations affiliées. «Les Noirs souffrent, poursuit ce pharmacien d’origine béninoise. Combien de jeunes Noirs diplômés sont réduits à occuper des postes de vigiles ? La France a toujours appréhendé les discriminations sociales mais jamais les discriminations ethno-raciales.»
Assemblée nationale, 26 novembre 2005. Ils sont tous là pour lancer le Conseil représentatif des associations noires (Cran) : l’ancien porte-parole des Verts, Stéphane Pocrain, le chanteur Manu Dibango, l’ancien président de SOS Racisme, Fodé Sylla, le footballeur Basile Boli. Leur point commun : la couleur de la peau, noire. Leur objectif : jouer le rôle d’un «lobby» à l’américaine pour défendre les intérêts des Noirs de France. « Le Cran est né d’une prise de conscience que la couleur de la peau fédère», explique Patrick Lozès, président du Cran qui revendique plus de cent associations affiliées. «Les Noirs souffrent, poursuit ce pharmacien d’origine béninoise. Combien de jeunes Noirs diplômés sont réduits à occuper des postes de vigiles ? La France a toujours appréhendé les discriminations sociales mais jamais les discriminations ethno-raciales.»
La création d’une fédération d’associations «noires» est une première en France. Vingt ans après la Marche des beurs contre le racisme et pour l’égalité des droits, elle est révélatrice d’une montée des revendications identitaires chez les Noirs vivant dans l’Hexagone. Qu’il s’agisse des Antillais, qui sont Français depuis plusieurs siècles, ou des enfants d’immigrés africains, naturalisés ou nés en France, «l’expérience commune de l’humiliation et du rejet en raison de la seule couleur de la peau a créé un sentiment d’appartenance commun, mélange de défiance et de revendication», analyse ainsi le haut fonctionnaire Richard Senghor (1), petit neveu de Léopold Sédar Senghor, président-poète du Sénégal, mort en 2001.
Discriminés dans l’emploi et le logement (lire p. II), sous-représentés dans les médias ou les partis politiques (lire p. II), les Noirs ont été également oubliés des débats sur l’intégration, longtemps dominés par la seule question de l’immigration maghrébine. «Leurs problèmes ont été mis de côté alors que ce sont eux qui vivent dans les logements les plus insalubres, eux qui occupent les emplois les plus pénibles, reconnaît le secrétaire national du PS, Malek Boutih. Les Noirs sont invisibles, alors qu’ils subissent une marginalisation et un racisme très intenses dans la société française.»![]()
Une loi perçue comme une offense supplémentaire
![]() Cette lutte contre l’injustice sociale se double d’une lutte pour une reconnaissance symbolique. «Chaque Noir de France a une histoire familiale qui inclut des méfaits et des souffrances qu’il voudrait voir reconnaître, analyse l’historien à l’Ehess, Pap N’Diaye, membre fondateur du Cran. Mais il se heurte à l’indifférence des pouvoirs publics. L’article 4 de la loi du 23 février 2005 qui reconnaît le rôle positif de la colonisation outre-mer a été perçu comme une offense supplémentaire.» Pour le sociologue au CNRS, spécialiste des sociétés de la Caraïbe, Michel Giraud (2), «la lutte contre les discriminations a redonné vie à des revendications liées au passé, à la colonisation et à l’esclavage». «Les discriminations, poursuit le sociologue, sont elles-mêmes motivées par des stéréotypes – l’idée que le Noir est un être inférieur – qui se sont forgés aux temps de l’esclavage et de la colonisation.»
Cette lutte contre l’injustice sociale se double d’une lutte pour une reconnaissance symbolique. «Chaque Noir de France a une histoire familiale qui inclut des méfaits et des souffrances qu’il voudrait voir reconnaître, analyse l’historien à l’Ehess, Pap N’Diaye, membre fondateur du Cran. Mais il se heurte à l’indifférence des pouvoirs publics. L’article 4 de la loi du 23 février 2005 qui reconnaît le rôle positif de la colonisation outre-mer a été perçu comme une offense supplémentaire.» Pour le sociologue au CNRS, spécialiste des sociétés de la Caraïbe, Michel Giraud (2), «la lutte contre les discriminations a redonné vie à des revendications liées au passé, à la colonisation et à l’esclavage». «Les discriminations, poursuit le sociologue, sont elles-mêmes motivées par des stéréotypes – l’idée que le Noir est un être inférieur – qui se sont forgés aux temps de l’esclavage et de la colonisation.»
Surfant sur les frustrations, l’humoriste Dieudonné, né d’un père camerounais et d’une mère bretonne, a joué, au rythme de déclarations sulfureuses, un rôle de catalyseur. L’artiste, entré en politique dès 1997, cherche à fédérer des populations disparates autour d’un discours identitaire visant à dénoncer le passé esclavagiste de la France, et les injustices dont les Noirs seraient encore victimes aujourd’hui. Plusieurs fois traîné devant les tribunaux, l’humoriste œuvre, au passage, à mettre en concurrence la mémoire des traites négrières avec celle de la Shoah. «Dieudonné a contribué à mettre sur le devant de la scène un problème dont on ne parlait pas assez en France, reconnaît Michel Giraud. Mais il l’a mal posé, en ouvrant la voie à une véritable concurrence victimaire.»
Quoi qu’il en soit, les Antillais et les Africains n’ont pas attendu l’humoriste – dont beaucoup se désolidarisent – pour s’interroger sur leur passé. «La grogne des Antillais de métropole existe depuis longtemps, observe Marie-Georges Peria, vice-présidente du Centre d’études et de recherches des Français d’outre-mer (Cerfom). Beaucoup ont été déçus en arrivant dans l’Hexagone. Mais leurs frustrations, leur quête identitaire, étaient difficiles à formuler. Avec le 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, en 1998, les originaires d’outre-mer ont trouvé un point focal pour commencer à exprimer ce qu’ils ressentaient. Depuis, les revendications s’amplifient de tous les côtés.»
La célébration de ce 150e anniversaire marque de fait un tournant. La marche silencieuse organisée, à cette occasion, à Paris, le 23 mai 1998, est un succès : 40 000 personnes marchent entre Vincennes et Nation, sous le slogan «esclavage, crime contre l’humanité». «Il s’agit alors d’insister sur la responsabilité directe de la France dans cette histoire, trop longtemps occultée, commente le président du Comité marche du 23 mai, Serge Romana, généticien à l’hôpital Necker à Paris. Nous ne voulions pas que la France commémore l’abolition de l’esclavage en 1848, mais la mémoire de nos aînés, enfin reconnus comme victimes, au même titre que les juifs ou les arméniens. Car nous sommes filles et fils d’esclaves !»![]()
Antillais et Africains reconnaissent que la couleur de la peau fédère
![]() Cette première marche défile dans une indifférence quasi générale. Mais le mouvement est lancé et se poursuit avec le dépôt d’une proposition de loi visant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité, portée par la députée de Guyane, apparentée socialiste, Christiane Taubira. Le Sénat adopte la loi le 10 mai 2001. Une première en Europe. Un Comité pour la mémoire de l’esclavage est créé dans la foulée. Présidé par l’écrivain guadeloupéenne Maryse Condé, il est notamment chargé de proposer une date nationale de commémoration de l’esclavage.
Cette première marche défile dans une indifférence quasi générale. Mais le mouvement est lancé et se poursuit avec le dépôt d’une proposition de loi visant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité, portée par la députée de Guyane, apparentée socialiste, Christiane Taubira. Le Sénat adopte la loi le 10 mai 2001. Une première en Europe. Un Comité pour la mémoire de l’esclavage est créé dans la foulée. Présidé par l’écrivain guadeloupéenne Maryse Condé, il est notamment chargé de proposer une date nationale de commémoration de l’esclavage.
Parallèlement, les Noirs de France s’organisent. Avant 1998, une nébuleuse de structures coexistent ; les multiples associations culturelles antillaises d’un côté, les associations de travailleurs africains, de l’autre. Mais en décembre 1999, la romancière Calixthe Beyala et le metteur en scène Luc Saint-Eloi créent le collectif Égalité, qui fédère 200 associations afro-antillaises. Le mouvement dénonce la non-représentation de la diversité ethnique sur les écrans et réclame des quotas. Il s’agit de la première association à ouvrir en France le débat sur les « minorités visibles » et la discrimination positive. Antillais et Africains reconnaissent que la couleur de la peau fédère et forge une identité commune, au-delà des divergences.
C’est l’année 2005 qui voit véritablement se poser une «question noire» en France, avec une succession d’événements. En mars, des intellectuels, dont Alain Finkielkraut, lancent un appel contre le «racisme anti-blanc», après des manifestations lycéennes au cours desquelles de jeunes Noirs auraient agressé des manifestants, Blancs. En août, l’incendie de deux immeubles insalubres fait 24 victimes à Paris, toutes africaines. Lors des violences urbaines de novembre, la police constate que de jeunes noirs se trouvent souvent en première ligne des affrontements. En décembre, des Antillais s’opposent à la célébration du bicentenaire de la bataille d’Austerlitz, parce que remportée «par un négrier nommé Napoléon Bonaparte». Enfin, Nicolas Sarkozy annule un déplacement aux Antilles devant le tollé que suscite le refus des députés UMP d’abroger le fameux article 4 de la loi du 23 février 2005 sur l’enseignement du «rôle positif de la présence française outre-mer».![]()
L’année 2005 aura été celle de la cristalisation d’une identité noire revendiquée
![]() «Le lien entre tous ces événements, c’est la question ethno-raciale, résume l’historien Pap N’Diaye. Les Noirs deviennent visibles dans l’espace public.» «L’année 2005 aura été celle de la cristalisation d’une identité noire revendiquée, d’une colère noire exprimée, ajoute Richard Senghor. Comme si, lasse de subir cette image d’éternelle victime, était soudain née une “communauté noire” déterminée à remettre les pendules à l’heure, à commencer par celles de l’Histoire. Même si ce retour en force du biologique a de quoi interpeller.» Et c’est d’ailleurs bien le cas. Pour le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, «la question noire n’existe pas». Selon lui, les Noirs de France ne se reconnaissent pas dans cette fabrication identitaire mise au service de revendications communautaires.
«Le lien entre tous ces événements, c’est la question ethno-raciale, résume l’historien Pap N’Diaye. Les Noirs deviennent visibles dans l’espace public.» «L’année 2005 aura été celle de la cristalisation d’une identité noire revendiquée, d’une colère noire exprimée, ajoute Richard Senghor. Comme si, lasse de subir cette image d’éternelle victime, était soudain née une “communauté noire” déterminée à remettre les pendules à l’heure, à commencer par celles de l’Histoire. Même si ce retour en force du biologique a de quoi interpeller.» Et c’est d’ailleurs bien le cas. Pour le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, «la question noire n’existe pas». Selon lui, les Noirs de France ne se reconnaissent pas dans cette fabrication identitaire mise au service de revendications communautaires.
De fait, quoi de commun entre un citoyen originaire d’un département d’outre-mer installé en métropole, un immigré originaire d’Afrique subsaharienne ou un réfugié politique arrivant d’Afrique centrale ? «Rien, tranche Patrick Karam, président du collectif des Antillais, Guyanais et Réunionnais, qui revendique 10 000 membres. Ce n’est pas parce que l’on est noir que l’on a le même passé, les mêmes attentes. Les Antillais, par exemple, sont davantage préoccupés par le problème de la continuité territoriale que par celui des discriminations.»
D’autres reprochent à ce mouvement identitaire de se tromper de combat. «Jusqu’à quand les Noirs seront descendants d’esclaves ou de colonisés ? Quelle énergie perdue dans la déploration victimaire !», s’agace l’auteur de Je suis noir et je n’aime pas le manioc (3), Gaston Kelman, qui admet pourtant qu’il existe «un problème racial» en France. Pour le sociologue Michel Giraud, «se servir du passé pour solder les comptes du présent n’est pas une bonne stratégie». Et s’il est «essentiel de lutter contre les discriminations raciales», «la solution ne devrait pas passer par la revendication d’une identité noire», laquelle «contribue à la fragmentation de la société». Pour Michel Giraud, « chacun doit faire en sorte que la réappropriation du passé dont il porte encore les marques ne devienne pas une fixation passéiste qui clotûrerait l’avenir».
Solenne de ROYER